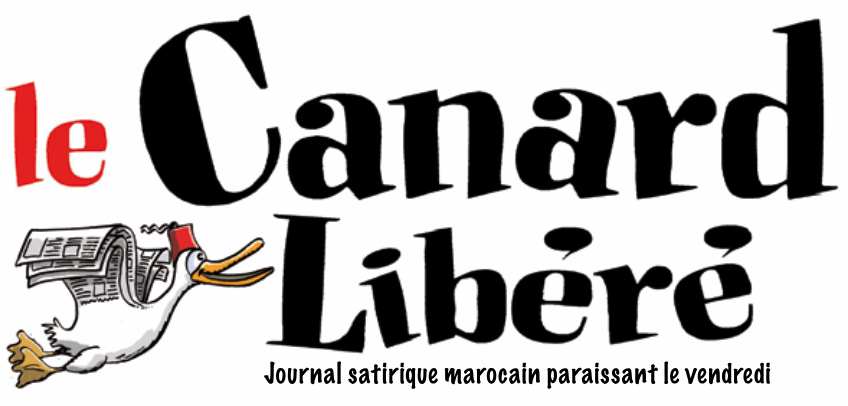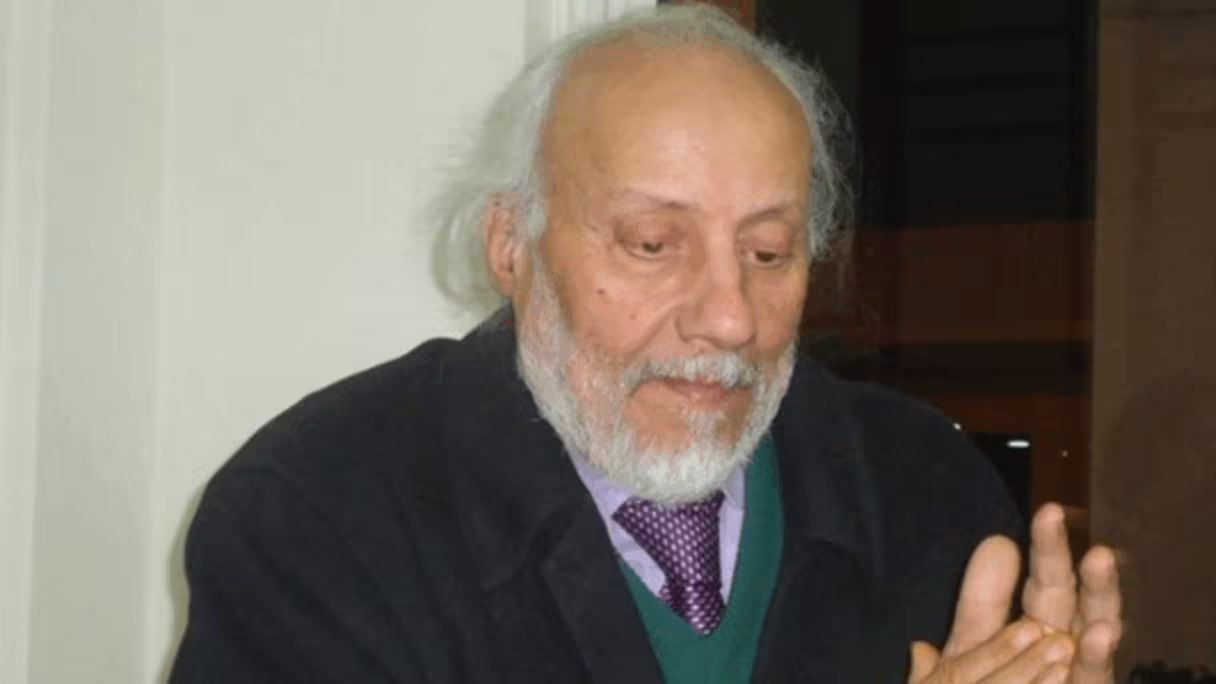Dans cet entretien, Nabil Adel, enseignant chercheur à l’ESCA, commente dans cet entretien les principales caractéristiques de l’année qui s’achève sur le plan national et international tout en esquissant les contours de celle qui vient.
Propos recueillis par Jamil Manar
Le Canard Libéré : De votre point de vue d’expert, l’année 2024 est-elle une année que le Maroc a terminée sous de bons auspices ?
Nabil Abdel : L’année 2024 a été marquée par des défis significatifs pour le Maroc, notamment une crise hydrique sévère qui a affecté le secteur agricole, représentant 13 % du PIB et plus de 30 % des emplois. Sur le plan économique, le pays a connu une croissance du PIB estimée à 3,5 % en 2024, soutenue par la vigueur de l’investissement et des exportations. Quant à l’inflation, elle a baissé à 2,3 %.
Cependant, l’année 2024 se termine sur des signes inquiétants pour le Maroc, avec des défis économiques, sociaux et environnementaux qui n’ont pas été adéquatement pris en charge par le gouvernement. La sécheresse et le stress hydrique, qui ont frappé particulièrement le secteur agricole, ont mis en lumière une mauvaise gestion de la ressource en eau, exacerbée par le manque de vision à long terme en matière de politique environnementale. Le gouvernement n’a pas su anticiper ces crises malgré des alertes répétées. Le chômage, notamment chez les jeunes, reste un fléau persistant. La situation est d’autant plus préoccupante avec l’explosion du phénomène des NEET (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation). Ce phénomène démontre l’incapacité du gouvernement à offrir des perspectives aux jeunes marocains, notamment dans un contexte où l’accès à une éducation de qualité et à des opportunités professionnelles demeure limité.
Le chantier de l’État social, qui avait pourtant été annoncé comme une priorité, semble être en panne. Les mesures mises en place pour soutenir les populations vulnérables sont insuffisantes et mal appliquées, maintenant de nombreuses familles dans la précarité. Plus grave encore, la vie chère persiste, ce qui affecte directement le pouvoir d’achat des citoyens, en particulier les plus défavorisés. Le gouvernement semble plus préoccupé par des réformes économiques symboliques que par des actions concrètes en faveur de la population. Et puis, le millésime 2024 a été marqué par le manque d’efficacité des politiques publiques et par un éloignement croissant des aspirations populaires. Les réformes promises sont restées lettre morte, et le pays semble s’enliser dans une crise socio-économique sans réelle perspective de sortie.
Justement, quelle lecture faites-vous de la situation des finances publiques ?
La situation des finances publiques met en lumière plusieurs défis majeurs. Le déficit budgétaire continue de croître, atteignant 40,5 milliards de dirhams à fin octobre 2024, avec un besoin de financement accru en raison de l’augmentation de l’endettement public. Bien que les recettes fiscales aient progressé de 13 %, cette hausse semble déconnectée de la croissance économique, suggérant que les mesures prises pour l’augmenter pourraient être temporaires. Parallèlement, les dépenses publiques connaissent une hausse importante, notamment les dépenses de fonctionnement et le service de la dette qui exercent une pression forte sur les finances de l’État. L’augmentation des dépenses de fonctionnement, combinée à l’augmentation des intérêts de la dette, surtout de la dette extérieure, rend la situation budgétaire fragile et suscite des inquiétudes quant à la capacité du pays à maintenir un endettement soutenable. Enfin, la réduction de la charge de compensation, en dépit de la vie chère, a des implications sur le pouvoir d’achat des couches vulnérables. Dans l’ensemble, la situation des finances publiques du pays présente des signes préoccupants, notamment un déficit croissant, une pression fiscale accrue et une dette de plus en plus difficile à gérer. La combinaison de ces facteurs pourrait limiter la flexibilité budgétaire et mettre en péril la résilience économique du pays.
Le chômage des jeunes et la vie chère sont les principaux dossiers où le gouvernement a montré bien des insuffisances. Quelle analyse faites-vous de ces deux phénomènes et comment les résorber ?
Le chômage des jeunes et l’augmentation du coût de la vie sont des défis majeurs. Le Maroc fait face à un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé, avec 26,6 % des jeunes de 15 à 24 ans sans emploi, études ou formation, l’un des plus élevés de la région MENA. Le chômage au Maroc est également alimenté par une faible croissance économique. En effet, une croissance modeste du PIB, estimée à 3,2 % pour 2024, n’est pas suffisante pour absorber le nombre croissant de jeunes entrants sur le marché du travail. La faible dynamique de certains secteurs clés, combinée à une économie encore dépendante de certains secteurs traditionnels et vulnérables aux chocs externes, limite la création d’emplois durables. Cela entraîne une inadéquation entre l’offre de travail et la demande du marché, accentuant le chômage, notamment parmi les jeunes diplômés et les populations vulnérables.
Pensez-vous que les aides directes entrées en vigueur à partir de 2024 sont de nature à compenser cette perte de pouvoir d’achat et relancer la consommation intérieure ?
Les aides directes introduites en 2024 sont certainement une bonne mesure pour soulager les populations les plus vulnérables, en particulier face à l’augmentation du coût de la vie. Elles permettent de réduire momentanément les inégalités et d’offrir un soutien financier crucial à ceux qui sont les plus affectés par l’inflation et les pressions économiques. Toutefois, ces aides, bien qu’importantes, risquent de ne pas être suffisantes à long terme car ne traitant pas les causes structurelles du problème, à savoir une croissance économique insuffisante et un marché du travail qui peine à créer des emplois durables. Pour que ces aides aient un impact véritablement transformateur, elles doivent être accompagnées de politiques visant à stimuler une croissance économique soutenue, à diversifier l’économie et à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes et les populations les plus fragiles. Sans une croissance économique significative, les aides risquent de n’être qu’une solution temporaire, sans effet durable sur la relance de la consommation intérieure.
A votre avis, quels sont les domaines sur lesquels le Maroc doit s’appuyer pour asseoir son développement sur des bases solides et favoriser une croissance à deux chiffres ?
Le Maroc doit se concentrer sur plusieurs leviers clés pour bâtir une économie résiliente et durable :
– Facilitation de la vie des TPME : Les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) sont des moteurs importants de l’emploi et de la croissance locale. En simplifiant les procédures administratives, en facilitant l’accès au financement et en créant un environnement plus favorable, le Maroc peut encourager l’innovation et la création de valeur à l’échelle nationale.
– Lancement d’une nouvelle génération de métiers mondiaux : Le Maroc doit se positionner sur des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l’intelligence artificielle, et les énergies renouvelables. En développant des formations adaptées et en incitant les entreprises à investir dans ces domaines, l’économie peut se diversifier et créer des emplois qualifiés.
– Encouragement des exportations : Le développement des exportations est crucial pour la croissance économique. Le Maroc doit renforcer sa compétitivité en diversifiant ses marchés d’exportation, en renforçant sa compétitivité-prix, et en conslidant sa présence dans les chaînes de valeur mondiales.
– Maintien de la politique des investissements en infrastructures : Les infrastructures sont la clé du développement à long terme. L’investissement dans des projets d’infrastructures de qualité (routes, ports, aéroports, etc.) stimule la croissance économique et améliore la connectivité et l’efficacité du marché.
– Réduction du train de vie de l’État : Un contrôle plus strict des dépenses publiques et une réduction du train de vie de l’État sont nécessaires pour libérer des ressources afin de soutenir les priorités de développement, telles que l’éducation, la santé et la réduction de la dette.
– Baisse de la pression fiscale : Une réduction de la pression fiscale sur les entreprises et les particuliers, en particulier les petites et moyennes entreprises, peut stimuler la consommation, encourager l’investissement et favoriser un environnement économique plus propice à la création de richesse.
En concentrant les efforts sur ces domaines, le Maroc peut établir des bases solides pour une croissance durable et inclusive à long terme.
Les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles dans le domaine des infrastructures en prévision de la coupe du monde 2030. Qu’est-ce que le pays est en droit d’attendre en termes de retombées de cet événement planétaire ?
La Coupe du Monde 2030 pourrait offrir au Maroc des retombées significatives en termes de visibilité internationale. Un événement de cette ampleur permettrait au pays de se mettre en avant sur la scène mondiale, non seulement en tant que destination touristique, mais aussi comme un acteur clé en Afrique et dans la région MENA. Cette visibilité pourrait également favoriser des investissements étrangers, renforcer les relations diplomatiques et dynamiser les échanges commerciaux. De plus, cet événement représente une opportunité de modernisation des infrastructures, notamment dans les secteurs du transport, des stades et des installations publiques. Ces investissements dans les infrastructures devraient, à long terme, bénéficier à la population, en améliorant la connectivité et en facilitant la mobilité, ce qui stimulerait le développement économique et social du pays.
Cependant, l’organisation d’un tel événement mondial comporte également des risques, notamment en termes de dépenses publiques. Les coûts associés à la construction de nouvelles infrastructures, à la sécurisation de l’événement et à l’organisation des villes hôtes peuvent être exorbitants. Cela pourrait entraîner une explosion des dépenses publiques et une augmentation significative de l’endettement national, ce qui pourrait compromettre la stabilité financière du pays si les investissements n’apportent pas les retombées économiques espérées. De plus, il existe un risque que certaines infrastructures restent sous-utilisées après la Coupe du Monde, ce qui limiterait leur rentabilité à long terme.
Bien que la Coupe du Monde 2030 présente des avantages indéniables en termes de visibilité internationale et de modernisation des infrastructures, il est crucial que le Maroc gère soigneusement les dépenses et s’assure que les investissements réalisés génèrent des bénéfices durables à l’économie. Le Mondial offre une grande opportunité, mais il doit être intégré dans une stratégie économique à long terme pour éviter des déséquilibres financiers.
Côté décollage économique et industriel, le Maroc est un peu à la peine alors qu’il est confronté à des défis énormes et croissants dans bien des domaines. Comment expliquez-vous cette situation?
Le Maroc connaît une stagnation économique marquée par des taux de croissance faibles et un chômage élevé, atteignant actuellement 13,5 % et progressant vers les 15 %. Cette situation met en lumière le manque d’efficience des politiques publiques, notamment celles visant à l’emploi, qui n’ont pas su répondre aux ambitions initiales, telles que la promesse d’un million d’emplois. Aujourd’hui, les Marocains espèrent simplement préserver les emplois existants face à une conjoncture qui met en évidence les failles structurelles de l’économie nationale. Une première explication réside dans le poids excessif du secteur public. Depuis des décennies, la croissance repose principalement sur l’investissement public et la redistribution des richesses, souvent financée par la dette. Ce modèle a créé une fausse croissance, ne générant pas de richesses réelles, tout en imposant une lourde charge au secteur privé. De plus, l’administration publique, bien que surdimensionnée, ne crée pas directement de richesses, limitant ainsi les ressources disponibles pour le secteur privé. Les récentes augmentations de salaires dans la fonction publique aggravent ce problème en détournant davantage de ressources pouvant être orientés vers des investissements productifs.
Un autre problème et non des moindres réside dans la faible productivité du travail, aggravée par un déclin démographique accéléré. Le Maroc peine à compenser la lente évolution de sa population active par une augmentation de la productivité. Cette faiblesse se reflète dans un PIB par habitant très bas et des niveaux de salaire souvent décrétés par la voie politique au lieu d’être générés par une création effective de la richesse. La prédominance du secteur informel et des secteurs à faible valeur ajoutée, comme l’agriculture traditionnelle et les services de base, limite encore davantage les opportunités d’emplois bien rémunérés et freine la croissance économique.
La lenteur des cycles économiques constitue une autre entrave. Les délais excessifs d’exécution des commandes publiques, la faible productivité durant certaines périodes comme le Ramadan, et un nombre élevé de jours fériés affectent négativement le rythme des transactions. Ces interruptions régulières limitent la capacité du pays à accélérer le rythme de sa productivité et sa croissance économique.
Enfin, le modèle économique marocain repose principalement sur la demande intérieure, ce qui réduit les opportunités de croissance. Le marché intérieur, étroit et peu dynamique, ne permet pas d’absorber de nouvelles entreprises sans cannibaliser les activités existantes. Cette situation freine l’innovation et la création de richesse à grande échelle.
Quels leviers actionner pour lever ces freins et instaurer un cercle économique vertueux?
Les solutions à ces défis requièrent des réformes profondes et courageuses, notamment pour moderniser les infrastructures, améliorer l’éducation, et dynamiser les secteurs à fort potentiel. Ces réformes risquent de rencontrer de fortes résistances, rendant leur mise en œuvre difficile. Mais elles sont nécessaires pour avancer.
Le monde continue à être déstabilisé par les guerres de type classique. La guerre en Ukraine déclenchée en 2022 et le génocide sioniste contre la population de Gaza lancé en octobre 2023. Quelle lecture géopolitique faites-vous de ces deux guerres ?
Les guerres contemporaines, qu’elles soient classiques ou asymétriques, témoignent des tensions persistantes dans l’ordre géopolitique mondial. La guerre en Ukraine et la guerre à Gaza illustrent deux dynamiques distinctes, mais elles convergent dans leur impact sur la stabilité mondiale, révélant les fractures géopolitiques profondes et les limites du droit international.
La guerre en Ukraine, déclenchée en février 2022 par l’invasion russe, est avant tout une manifestation des rivalités géopolitiques entre grandes puissances. Elle traduit le retour des conflits interétatiques en Europe, marquant une rupture avec la relative stabilité observée depuis la fin de la Guerre froide. La Russie cherche à redéfinir les équilibres de puissance en Europe de l’Est, en contestant l’élargissement de l’OTAN et l’influence occidentale dans sa sphère géographique.
Ce conflit a non seulement redessiné les alliances stratégiques mondiales, mais a également mis en lumière la dépendance énergétique de nombreux États européens et leurs vulnérabilités économiques. Par ailleurs, il a entraîné une polarisation du système international, avec un bloc occidental soutenant l’Ukraine et un groupe de puissances émergentes, comme la Chine, observant ou soutenant implicitement la Russie. Cette guerre a également révélé les limites de l’ONU, incapable d’agir efficacement face à un conflit impliquant un membre permanent du Conseil de sécurité.
Le conflit à Gaza, intensifié en octobre 2023, s’inscrit dans une logique différente mais tout aussi déterminante. Il illustre un conflit asymétrique enraciné dans un contentieux historique lié à la colonisation et aux droits des populations palestiniennes. Les bombardements intensifs sur Gaza, qualifiés de génocide, révèlent une escalade de violence sans précédent, avec des répercussions humanitaires dramatiques.
Ce conflit met en lumière l’échec des solutions politiques pour résoudre la question palestinienne, ainsi que le soutien indéfectible de l’occident, principalement les États-Unis, à Israël, malgré les critiques croissantes sur la scène mondiale. La gestion de ce conflit divise profondément les opinions publiques et accentue la méfiance entre les pays du Nord et ceux du Sud global, notamment les pays arabes et musulmans.
Ces deux guerres, bien qu’ayant des dynamiques différentes, révèlent des tendances géopolitiques communes. Elles marquent un recul de l’ordre multilatéral et du droit international, où les intérêts nationaux des grandes puissances et des États régionaux priment sur les principes du droit international. Ces conflits exacerbent également les tensions mondiales, alimentent les rivalités géoéconomiques, et approfondissent les fractures idéologiques et civilisationnelles. Enfin, ils soulignent la difficulté pour la communauté internationale de promouvoir une paix durable dans un monde multipolaire où les rapports de force se reconfigurent rapidement. Ces guerres constituent un rappel brutal des défis à relever pour construire un ordre mondial fondé sur la justice et la sécurité collective.
A quoi le monde doit s’attendre avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche compte tenu de l’inquiétude qui s’est emparée des dirigeants européens ?
Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis suscite de vives inquiétudes parmi les dirigeants européens, qui anticipent des répercussions significatives sur les relations transatlantiques et la stabilité mondiale.
L’une des principales préoccupations concerne le soutien américain à l’Ukraine. Donald Trump a exprimé son intention de réduire, voire de cesser, l’aide militaire à Kiev, ce qui pourrait affaiblir la position ukrainienne face à l’agression russe et modifier l’équilibre des forces en Europe de l’Est. Les dirigeants européens, conscients de cette menace, ont récemment intensifié leurs discussions pour renforcer leur soutien à l’Ukraine et assurer la sécurité du continent. Par ailleurs, les politiques commerciales protectionnistes prônées par Donald Trump, notamment l’imposition de droits de douane sur les produits européens, font craindre une escalade des tensions économiques entre les deux rives de l’Atlantique. Ces mesures pourraient perturber les échanges commerciaux, affecter les économies européennes et engendrer des représailles, menaçant ainsi la stabilité économique mondiale.
Face à ces défis, les dirigeants européens appellent à une plus grande unité et à une autonomie stratégique accrue. Le président français Emmanuel Macron a souligné la nécessité pour l’Europe de « prendre son destin en main » en renforçant sa souveraineté, notamment dans les domaines de la défense, de l’économie et de l’énergie. Cette position vise à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis et à préparer le continent aux incertitudes liées à la nouvelle administration américaine.
En outre, la réélection de Donald Trump pourrait exacerber les divisions au sein de l’Union européenne, certains dirigeants populistes européens ayant exprimé leur soutien à sa présidence. Cette situation pourrait compliquer la coordination des politiques européennes et affaiblir la cohésion du bloc face aux défis internationaux.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche impose à l’Europe de repenser ses stratégies en matière de sécurité, d’économie et de politique étrangère, en privilégiant l’unité et l’autonomie pour pouvoir trouver son chemin dans un environnement international de plus en plus incertain.