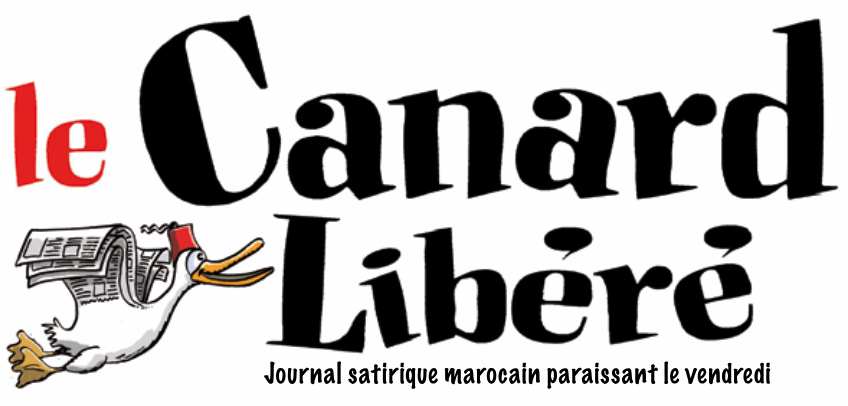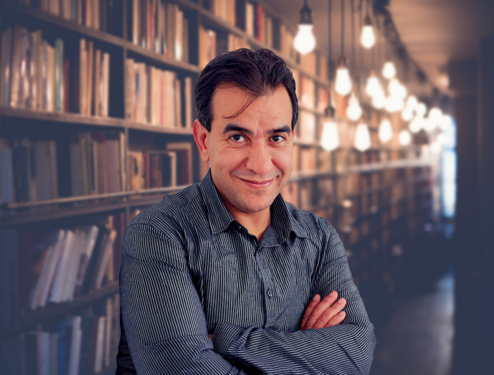Dans la torpeur de l’été et ses vagues de chaleur écrasante de juillet, l’actualité, dominée par la futilité informationnelle crachée à jet continu par les différents canons électroniques, fait une brusque embardée, basculant dans un coin enclavé et marginalisé du Maroc profond. Bonjour Aït Bouguemez dont la population berbère s’est rappelée au bon souvenir des responsables en organisant « une marche de la dignité » spectaculaire vers le siège de la préfecture à Azilal ! Ni jets de pierre, ni brutalité policière. Une action pacifique qui respire toutefois la détermination des marcheurs. Par centaines, les habitants des douars de cette vallée du haut Atlas central ont parcouru à pied, avec des drapeaux nationaux en l’air et une banderole géante avec une photo du souverain, plusieurs kilomètres pour faire connaître leurs revendications qui sont celles de bien des zones du monde rural : des routes de désenclavement, un médecin permanent pour soigner leurs malades, une couverture téléphonique et internet correcte, des espaces de récréation pour les jeunes… Une révolte pacifique qui a fait le tour du Maroc connecté qui n’ignore en rien l’état de sous-développement où est toujours maintenu le monde rural.
Face à la détermination des manifestants, le gouverneur a bien réagi en recevant leurs représentants auxquels il a promis une réponse sous huitaine à leurs doléances légitimes. Ces dernières s’inscrivent dans le processus du développement local dont les insuffisances chroniques mettent en lumière les défaillances des politiques publiques et de l’action locale. Or, la vallée des Aït Bouguemez, réputée pour la beauté époustouflante de ses paysages propices au tourisme de montagne, est censée disposer de tous les prérequis, en termes d’infrastructures de base et de loisirs nécessaires. Mais derrière la carte postale de rêve se cache une réalité sociale qui ne fait pas rêver…
Ici, c’est le trekking, très prisé par un public de randonneurs étrangers adeptes de l’écotourisme et de la découverte de la nature de manière responsable, qui constitue, avec l’élevage et l’agriculture, la principale source de revenu pour les montagnards. Mais la mise en tourisme de ce territoire se heurte à bien des déficits en termes de formation des guides et de gîteurs mais aussi d’accessibilité, d’offres de loisirs et de secours d’urgence qui freinent la promotion et le développement de l’économie montagnarde et atlasique en général. Alors que celle-ci est porteuse de formidables opportunités ( emplois, revenus…) pour les habitants des arrière-pays, ce tourisme-là reste le parent pauvre de la politique touristique nationale essentiellement tournée vers le tourisme des grands axes ( Marrakech, Agadir, Casablanca…) et les investissements en hôtellerie de luxe.
Vivement une agence de la ruralité ! Son rôle? impulser une véritable équité territoriale conformément aux hautes orientations royales.
Un projet de développement territorial digne de ce nom, bénéfique aussi bien aux populations qu’aux touristes, se construit avec de la concertation, de l’implication et de la coordination avec toutes les parties prenantes à l’échelle locale et régionale ( Tourisme, Intérieur, Transport, Santé, Habitat, développement durable…) et non pas depuis Rabat. La régionalisation ne doit pas rester un slogan pour meubler les discours de circonstance. Il faut qu’elle devienne une véritable institution politique qui agit sur le réel très peu reluisant du monde réel pour le changer.
Pour cela, les budgets existent mais ils sont visiblement mal alloués. Souvenez-vous du discours royal du Trône du 30 juillet 2009. Le souverain l’avait consacré à la nécessité du développement du monde rural et des zones montagneuses. Une commission ad hoc, présidée par le chef du gouvernement et réunissant pas moins de 17 départements ministériels, ne tiendra sa première réunion que le 13 juillet 2015, soit 6 ans après les hautes instructions royales ! Mais aucun programme de développement et de mise à niveau des zones concernées ne sera mis en œuvre. Jusqu’à ce que le séisme d’Al Haouz de septembre 2023 révèle au grand jour l’extrême vulnérabilité des populations sinistrées et l’ampleur du dénuement qui les frappe.
Les zones montagneuses c’est une superficie de 302.000 km2, près de 8 millions d’habitants, 738 communes et une faible contribution de 5% au PIB et 10% à la consommation nationale alors que ces territoires concentrent 70% du capital hydrique, 62% du patrimoine forestier et des ressources minérales considérables . Est-ce normal que toutes ces richesses n’aient pas permis aux montagnards de sortir de leur isolement et d’accéder aux services publics de base ? C’est pour cela qu’un sentiment d’abandon persiste chez la population rurale exposée en plus à la rudesse du climat ( grand froid et chaleurs extrêmes), aux inondations et aux tremblements de terre. Sans oublier les pénuries d’eau qui frappent de nombreux douars et villages. Dans certaines parties de ce Maroc oubliée, la condition paysanne s’est figée dans le siècle précédent…
Pacifique, la marche spectaculaire des habitants de Aït Bouguemez n’en est pas moins une alerte. Aux gouvernants d’agir, surtout que la situation du Maroc des campagnes, déjà miné par de nombreux déficits socio-économiques , risque de s’aggraver en raison des effets du changement climatique. Le cri du cœur de Aït Bouguemez souligne clairement l’échec des boutiques politiques qui ont fait du désenclavement du monde rural leur cheval de bataille et un fonds de commerce électoral juteux. Vivement une agence de la ruralité ! Son rôle? impulser une véritable équité territoriale conformément aux hautes orientations royales. La marche de Ait Bouguemez montre qu’il y a une urgence rurale.