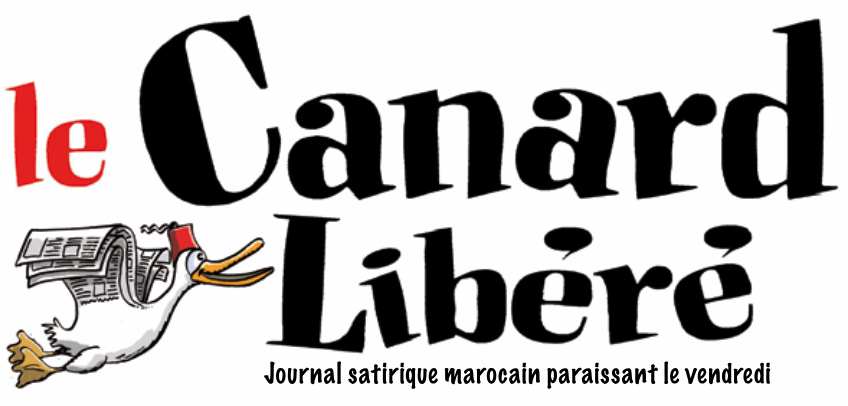Mouloud Benzadi *
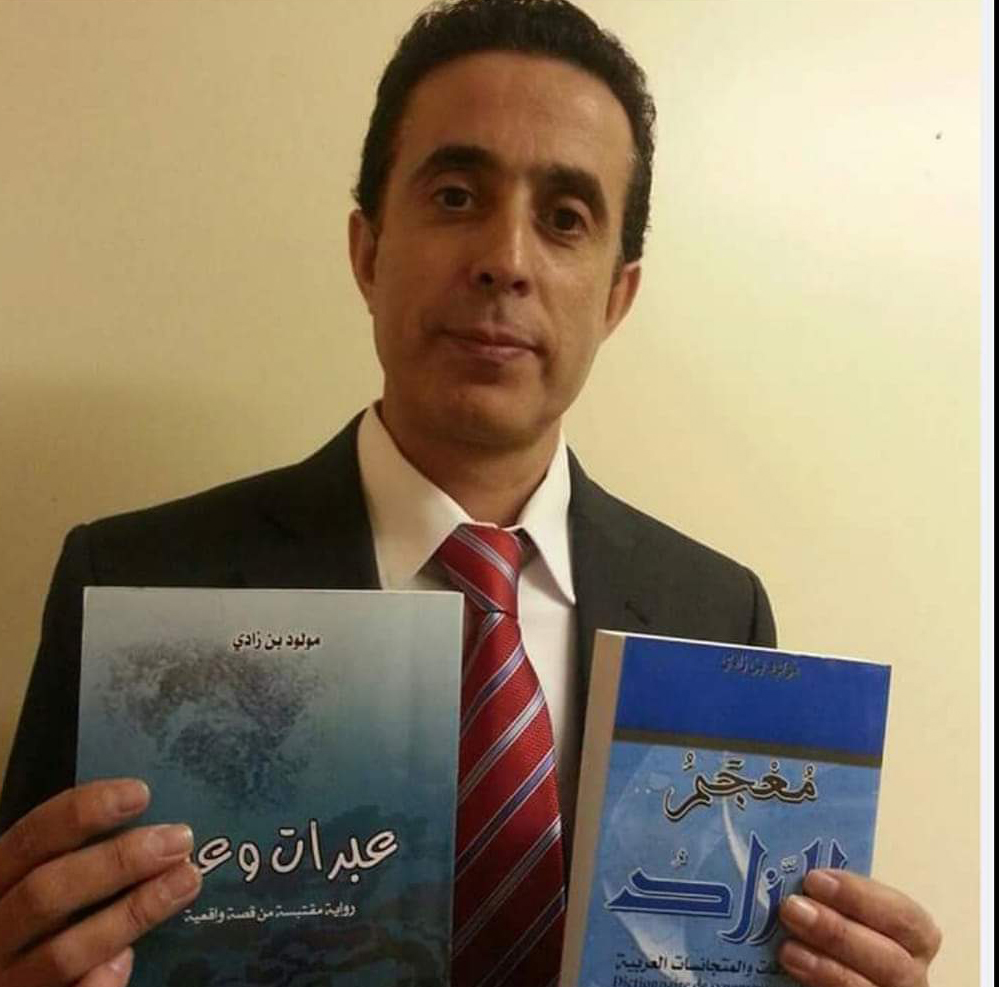
Dans mon précédent article, intitulé « Le droit des auteurs à utiliser l’IA : une proposition de règles claires », publié dans le journal Le Canard Libéré le 11 juillet 2025, je défendais l’idée que les auteurs puissent utiliser l’IA sans avoir à en faire mention, pour toutes les tâches traditionnellement assurées par des éditeurs humains, puisque ces tâches sont essentiellement identiques et n’en changeraient pas la nature. Je vais désormais approfondir cet argument en soutenant que les auteurs devraient bénéficier d’une liberté totale dans l’usage de l’IA, sous une seule condition que j’expliquerai tout au long de cet article.
L’IA s’introduit discrètement dans le monde de l’édition
Il est ironique de constater que, tandis que les cercles littéraires tiennent à préserver le caractère sacré de l’édition humaine, l’intelligence artificielle s’est déjà discrètement immiscée dans le processus. Les éditeurs ont commencé à utiliser ces outils en toute discrétion. Rien n’empêche aujourd’hui un éditeur de recourir à l’IA, à l’insu de l’auteur, pour relire, corriger, affiner un manuscrit, avant d’y apposer sa touche personnelle. Faut-il les blâmer pour cela? Certainement pas. Pourquoi passeraient-ils des heures à corriger grammaire, ponctuation ou structure, quand l’IA peut accomplir ces tâches en quelques secondes, leur faisant gagner un temps précieux?
La vraie question devient alors: si l’IA fait déjà partie du processus éditorial, pourquoi les auteurs en seraient-ils exclus? L’intégration de l’IA dans l’édition est inévitable. Comme l’a souligné la rédactrice Hazel Bird : « Je suis convaincue que l’IA aura un impact en transformant le travail des éditeurs. Je soupçonne une migration naturelle du travail de vérification des erreurs, moins axé sur le jugement, vers un travail plus nuancé et plus complexe d’amélioration du texte. »
Si l’IA aide les éditeurs, les auteurs doivent pouvoir l’utiliser aussi.
Le mythe de l’originalité pure en littérature
Tout au long de l’histoire, même les auteurs les plus renommés ont fait appel à d’autres personnes — conjoints, amis proches ou éditeurs — pour façonner leur œuvre. Ce soutien allait bien au-delà de simples relectures ou suggestions ponctuelles. Dans certains cas, il entraînait des transformations profondes, tant sur la structure que sur le style. “Frankenstein” de Mary Shelley, par exemple, a été fortement influencé par son mari, le poète Percy Bysshe Shelley, qui a apporté de nombreuses suggestions stylistiques avant la publication de 1818. Les chercheurs ont souligné son rôle dans la beauté des phrases et les effets de style, et se demandent combien il a vraiment influencé le ton final du livre.
Si l’on accepte qu’un être humain puisse remanier, réécrire ou transformer le style et le ton d’une œuvre tout en en préservant le nom de l’auteur, alors le recours à l’IA doit être envisagé dans le même esprit. Il n’existe pas de différence essentielle entre une IA qui réécrit un texte et un proche ou un éditeur humain qui le fait ; ce qui compte, c’est que les idées et la vision restent fidèles à l’intention de l’auteur.
Les traducteurs influencent l’expression, tout comme l’IA
Les romans traduits subissent souvent d’importantes transformations stylistiques lors de leur passage d’une langue à l’autre. Si les idées principales sont conservées, le ton, le rythme et la structure sont façonnés par le traducteur, dont l’interprétation et le sens linguistique influencent directement la version finale.
Un exemple marquant est celui des “Rubaiyat” d’Omar Khayyam, traduites et profondément remaniées par Edward FitzGerald en 1859. Sa version introduit de nouvelles formulations, une structure différente et une interprétation libre, modifiant significativement le ton et le style des vers persans d’origine. Pourtant, malgré ces changements, la paternité de l’œuvre reste attribuée à Omar Khayyam, et non à son traducteur.
Dans bien des cas, des œuvres traduites ont reçu des prix littéraires prestigieux, même lorsque la prose ne reflétait plus exactement le style de l’auteur original. Ce qui importe avant tout, c’est la force des idées, la profondeur de l’émotion, l’imaginaire créé par l’auteur — non pas l’exécution technique dans une langue donnée.
Si le monde littéraire accepte qu’un roman soit reconnu comme œuvre majeure alors que son style et son ton ont été modifiés par la traduction, le même principe devrait s’appliquer lorsqu’un auteur choisit d’utiliser l’intelligence artificielle pour l’aider à exprimer et structurer ses pensées. Les idées restent celles de l’auteur ; l’IA, comme un traducteur, ne fait que les rendre plus claires, cohérentes et accessibles. Il n’existe aucune raison valable de considérer ce type de collaboration comme moins légitime.
Le ghostwriting prouve que la collaboration est éthique
Depuis des décennies, des écrivains fantômes assistent les auteurs dans la rédaction de leurs livres, en s’appuyant sur la vision de ces derniers. L’auteur fournit les idées, partage son expérience ou définit l’orientation créative, guide le contenu, les thèmes et le ton général, et approuve le manuscrit final. L’écrivain fantôme, quant à lui, accomplit des tâches telles que la recherche, la rédaction, l’organisation du contenu, la clarification d’idées complexes, la réécriture pour améliorer la clarté, la fluidité ou le ton, ainsi que l’adaptation du style.
Cette pratique est jugée éthique car, même si l’écrivain fantôme façonne la forme et la structure, l’histoire naît de la perspective, de l’expérience ou du concept de l’auteur, ce qui justifie que celui-ci en conserve la paternité.
Cette propriété est d’ailleurs affirmée dans les annonces spécialisées, dont l’une précise : « Écrivains fantômes et auteurs primés : nos écrivains fantômes vous apportent autant de contributions que vous le souhaitez, et le produit final vous appartient entièrement. »
Si cette pratique est considérée comme une forme légitime et éthique de collaboration, il serait incohérent d’exclure l’intelligence artificielle d’un processus similaire.
Redéfinir la paternité littéraire à l’ère de l’IA
En l’absence de règles établies sur l’usage de l’intelligence artificielle en littérature, j’ai proposé dans un précédent article la règle suivante : « Autoriser l’IA à effectuer toute tâche normalement confiée à un éditeur humain. » À la lumière des éléments abordés ici, je propose désormais une formulation plus complète : « Autoriser l’IA à effectuer toute tâche, sans exception, à condition que les idées et les directives viennent de l’auteur. »
L’ironie est flagrante : de nombreux cercles littéraires continuent de s’indigner de l’usage de l’IA, alors que les auteurs ont toujours eu recours à leurs proches, à des amis, à des éditeurs, à des traducteurs ou à des écrivains fantômes pour modifier, réorganiser ou réécrire leurs œuvres. L’IA n’est pas un monstre inquiétant. Elle peut être utilisée comme un stylo ou un clavier — un simple moyen d’exprimer pensées, émotions et expériences. Et tant qu’elle ne génère pas les idées, aucun reproche ne devrait être adressé à l’auteur.
Si un écrivain peut faire appel à un proche, un ami, un éditeur, un traducteur ou un écrivain fantôme pour transformer son texte sans perdre la paternité de son œuvre, lui refuser ce droit lorsqu’il utilise l’IA relève d’un deux poids, deux mesures inacceptable. De nombreux livres traduits ont reçu des prix littéraires, même quand style et ton avaient été modifiés. Si ces formes de collaboration sont acceptées, alors l’IA doit aussi être reconnue comme un outil légitime, qui aide à la formulation, sans remplacer la vision de l’auteur.
L’apparition de l’IA dans le champ littéraire nous pousse à repenser les notions de littérature et de paternité littéraire. La littérature peut être définie comme une écriture en prose ou en vers qui transmet les idées, les thèmes et les messages de l’auteur, façonnés par une forme d’expression choisie. L’auteur est l’esprit derrière l’œuvre — celui qui conçoit, initie ou dirige le processus créatif. Qu’il fasse appel à un proche, à un éditeur, à un traducteur ou à une IA pour formuler ses pensées, clarifier son style ou structurer son texte ne change rien à l’essence de la paternité: les idées demeurent les siennes.
L’IA ne pense pas, ne crée pas d’idées originales, ne possède ni conscience ni souvenirs. Dans l’écriture, elle est un outil — dirigé par l’auteur — pour exprimer ses pensées, émotions, vécu, voix. En l’intégrant au processus créatif, l’auteur gagne en temps, en clarté, en efficacité, et peut se concentrer sur l’essentiel : le contenu, la vision, l’impact du message. Il est temps de reconnaître l’IA comme un outil légitime, au service de l’auteur, dans l’acte de création littéraire.
* Auteur, lexicographe et chercheur – Royaume-Uni