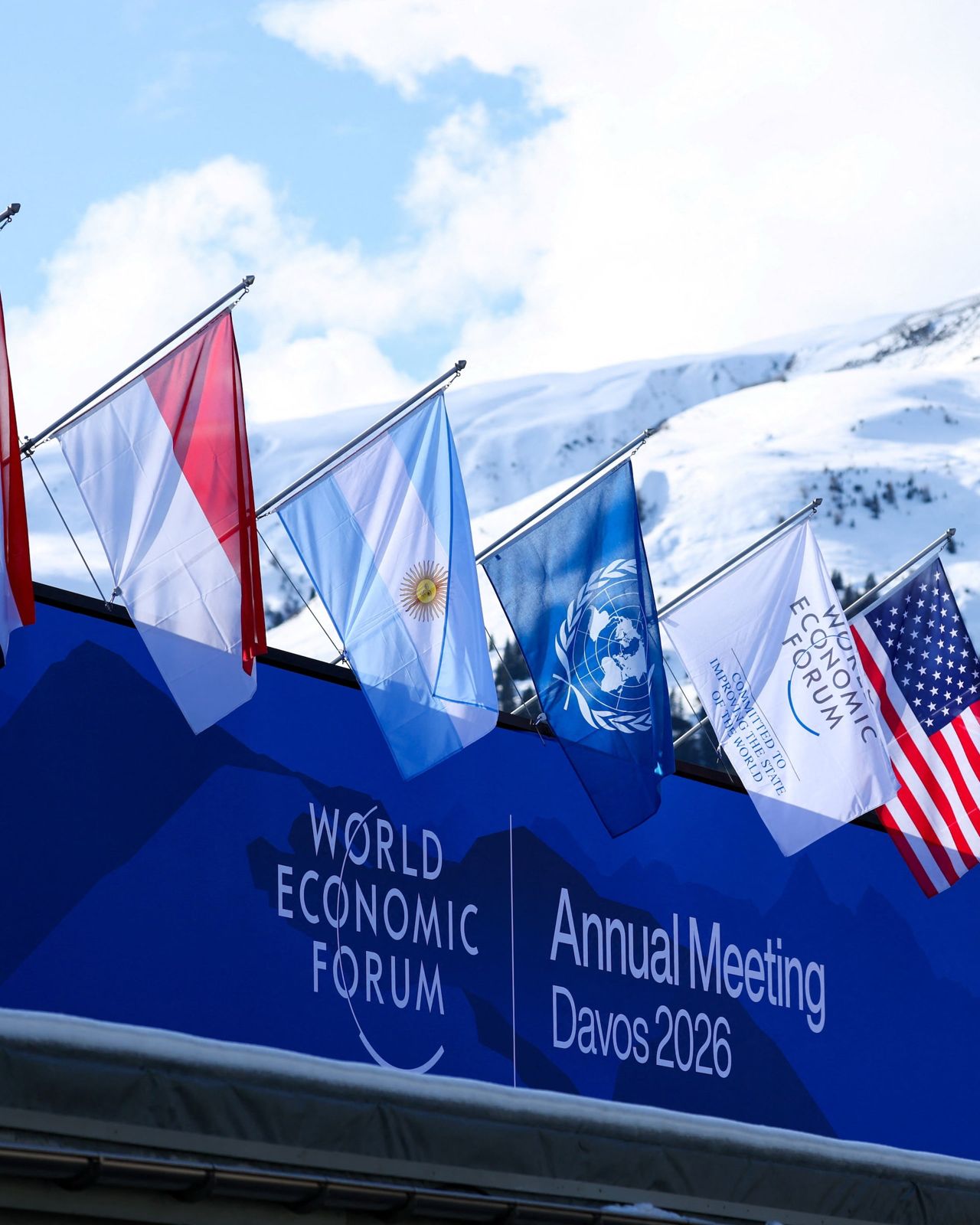L’annonce en début d’année par la direction du lycée Français Guy de Maupassant à Casablanca d’une nouvelle hausse des frais de scolarité a provoqué la colère des parents. Selon eux, cette hausse, décidée sans concertation, pèse lourdement sur le budget des familles.
Jamil Manar
Le Lycée Français Guy de Maupassant (LFM) de Casablanca se retrouve au centre d’une vive controverse en ce début d’année 2026, à la suite de l’annonce d’une nouvelle augmentation des frais de scolarité pour la rentrée 2026-2027. Une décision qui suscite l’incompréhension et la colère de nombreux parents d’élèves. L’Association des parents d’élèves (APEMA) dénonce une hausse décidée de manière unilatérale par le groupe IEG, gestionnaire de l’établissement, en contradiction avec un engagement de révision triennale des tarifs. Intégrée dans un nouveau règlement financier, cette augmentation concerne à la fois les frais de scolarité et les frais d’inscription, ravivant des tensions déjà latentes entre les familles et l’administration.
Fracture
Bien que le LFM soit un établissement partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), les parents estiment que ces hausses successives deviennent difficilement supportables. Pour rappel, les frais de scolarité pour l’année 2025-2026 oscillaient déjà entre 47 200 et 53 000 dirhams par an, hors frais d’inscription. Face à cette situation, l’APEMA a tiré la sonnette d’alarme, dénonçant l’absence de concertation et appelant à un dialogue avec la direction. Près de 400 parents ont d’ores et déjà apposé leur signature pour s’opposer à cette nouvelle augmentation, symbole, selon eux, d’une dérive tarifaire devenue récurrente. Ce qui est présenté aujourd’hui comme un « cas isolé » ressemble fortement à un scénario déjà vu, prélude à une généralisation silencieuse à l’ensemble des enseignes du réseau AEFE, sans véritable concertation ni possibilité de s’y opposer. Pour de nombreuses familles, il ne s’agit plus d’un simple ajustement tarifaire, mais d’un changement de cap assumé, imposé de manière unilatérale. Une pratique récurrente, vécue comme la remise en cause d’un équilibre déjà fragile.
L’« urticaire » bien connu des hausses refait systématiquement surface. Et avec lui, ce sentiment d’impuissance : trop engagés pour partir, trop dépendants du système pour espérer infléchir des décisions prises ailleurs et qui tombent comme un couperet. Dans le détail, la trajectoire annoncée a de quoi donner le vertige. Une augmentation de 4 % par an jusqu’en 2029 — au moins, cette fois, la pente est clairement balisée. À cela s’ajoutent de nouveaux Droits Annuels d’Inscription (DAI) : 4.000 dirhams dès l’année scolaire 2026-2027, puis 7.000 dirhams l’année suivante. La facture sera présentée en mai-juin 2027, juste à temps pour gâcher les vacances. Quant aux Droits de première inscription (DPI), ils grimperaient à 30.000 dirhams à partir de la rentrée 2026, un seuil jugé tout simplement dissuasif par de nombreuses familles. Certaines écoles privées affiliées au réseau AEFE envisageraient même d’aller plus loin encore, confirmant l’impression que ces hausses n’ont plus vraiment de plafond.
Mais au-delà des chiffres, c’est la répétition du schéma qui alarme. Chaque année, les parents protestent, s’indignent, interpellent. Et chaque année, faute de véritables leviers ou de recours institutionnels efficaces, la contestation s’éteint d’elle-même, laissant place à une résignation contrainte. Cette absence de contre-pouvoir nourrit un sentiment grandissant d’abus tarifaires tolérés, voire normalisés. Le malaise est d’autant plus profond que plane la menace d’un effet domino. Une baisse des effectifs est évoquée, avec à la clé des ajustements pédagogiques : regroupements de classes, réduction de l’offre éducative, affaiblissement potentiel de l’encadrement. La crainte d’une « double peine » s’installe alors : payer toujours plus, tout en redoutant une dégradation de la qualité de l’enseignement.
À cela s’ajoutent les annonces de coupes budgétaires : investissements différés, moyens limités, pression accrue sur les équipes éducatives. Le paradoxe est difficile à avaler pour les familles : des frais en hausse constante d’un côté, des ressources en baisse de l’autre. Une équation qui alimente la colère et l’incompréhension. Face à cette situation, les parents cherchent un arbitre. En vain. Le ministère de tutelle, affirment-ils, n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’en laver les mains, laissant aux établissements une large liberté tarifaire. Résultat : une régulation en panne et une impression de laisser-faire qui dépasse désormais le cas d’un seul lycée pour concerner l’ensemble du réseau AEFE. À ce renchérissement constant s’ajoute enfin la hausse continue des frais annexes — activités, services, contributions diverses — souvent annoncés en cours d’année, sans réelle transparence ni possibilité de contestation. Autant de prélèvements additionnels qui renforcent un sentiment largement partagé : celui d’être mis à contribution, méthodiquement, année après année.
La question n’est donc plus seulement celle d’une augmentation de plus, mais bien celle d’un système. Sans transparence, sans justification claire et sans véritable concertation, le risque est grand de voir s’installer durablement une fracture entre les familles et des établissements qui, à force de banaliser ces hausses, pourraient finir par rompre le lien de confiance indispensable au bon fonctionnement de l’école.
Offre éducative ou mercantile ?
Ahmed Zoubaïr
En toute logique, la France devrait pratiquer des frais de scolarité raisonnables à l’étranger, ne serait-ce que par instinct de survie linguistique. Car le français, malgré les discours officiels rassurants, recule à grande vitesse sur la scène internationale. Non seulement il cède du terrain face à l’anglais — langue des affaires, de la technologie et de la mondialisation — mais il s’effrite désormais jusque dans ses propres anciennes colonies, où l’anglais s’impose progressivement comme la langue de l’avenir.
On facture au prix fort le fait de parler français, comme si la langue de Molière était une marque premium, qui doit rester hors de prix ! Drôle de raisonnement antinomique avec la volonté de promouvoir la francophonie. À ce rythme, le français ne perd pas seulement du terrain : il se replie, pendant que son enseignement devient, paradoxe ultime, de plus en plus cher, voire scandaleusement inaccessible…
Or, le français n’est pas qu’une langue : c’est un véritable véhicule de culture, d’histoire et d’un art de vivre. À travers cette langue se transmettent des siècles de pensée philosophique, de littérature, de poésie et de science, mais aussi un certain goût de l’élégance, de la nuance et du débat. Apprendre le français, c’est entrer dans un monde où le mot compte autant que l’idée, où la discussion et le raffinement intellectuel ne sont pas accessoires mais essentiels.
La mission française devrait par conséquent être une arme douce de rayonnement culturel, un levier d’influence accessible, et non un business hautement juteux.
Sur le papier, les écoles de la mission française au Maroc sont censées incarner l’esprit de la coopération éducative : accessibilité, partage culturel, promotion de la francophonie et partenariat durable. Sur le papier seulement. Car dans les faits, cette noble ambition semble avoir été rangée dans un tiroir, remplacée par une logique nettement plus terre-à-terre : faire du chiffre. Encore et toujours.
Autrefois outil de rapprochement entre les peuples, la francophonie ressemble aujourd’hui à une offre mercantile, avec ses tarifs dissuasifs et une clientèle saignée à blanc. Un drôle de paradoxe pour une langue qui a tous les atouts pour devenir universelle. La mission française ne rayonne plus : elle facture. Triste tableau!