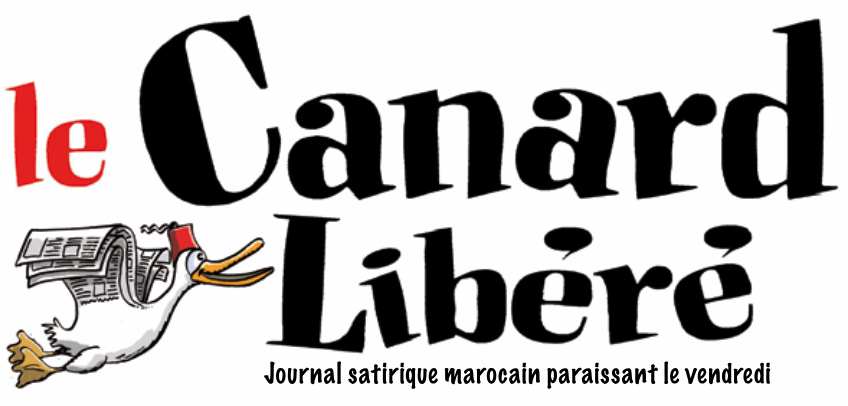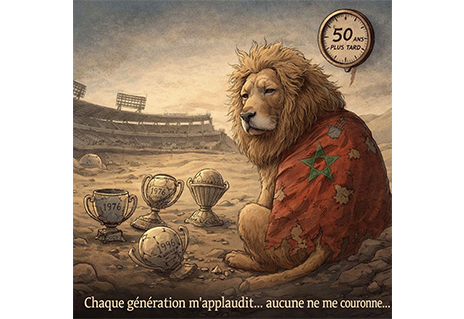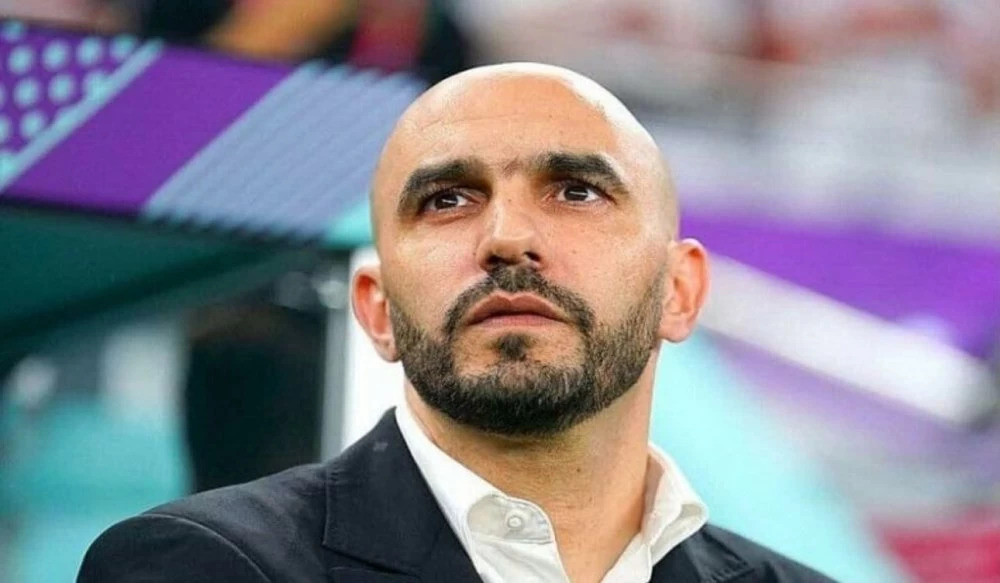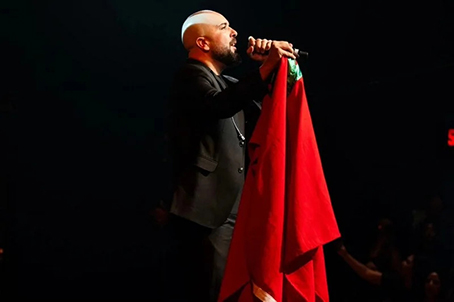Ancienne colonie espagnole récupérée en 1975, le Sahara marocain représente plus de la moitié du territoire national. Il couvre une superficie de 416 474 km², soit environ 58,6 % du pays.
Le Sahara marocain s’étire sur une superficie de 266 000 km² pour une population estimée à 500.000 habitants. s’étendant depuis le Nord-Ouest de l’Afrique, situé à 50 km des Îles Canaries, il est bordé par la province de Tarfaya au Nord, l’Algérie au Nord-Est et la Mauritanie à l’Est et au Sud, tandis que sa côte Ouest longe sur 1 200 km l’Atlantique, il possède une frontière avec l’Algérie sur 42 km, la Mauritanie sur 1 561 km. Les zones contrôlées par le Maroc et le Front Polisario sont séparées par un mur de sable long de 2 000 km, construit entre 1980 et 1987 par les autorités marocaines, pour se défendre contre les incursions des séparatistes soutenus et armés par l’Algérie.
Selon le découpage administratif national, trois régions font partie du territoire du Sahara qui couvre également le territoire situé au-delà du mur marocain.
La région Dakhla-Oued Eddahab. Région la plus australe et la plus vaste du Maroc, elle s’étend sur 142 865 km 2 pour une population de 143 000 habitants, soit 1% de la population nationale. La capitale régionale est Dakhla (110 000 habitants). La région de Laâyoune-Boujdour-Sakia Al Hamra. Occupant la partie centrale des régions sahariennes, elle abrite 370 000 habitants, soit 1,1 % de la population nationale, sur 140 018 km 2. La capitale régionale est Laayoune (220 000 habitants), ville la plus importante des provinces du sud.
La région de Guelmim-Oued Noun. Créée en 2015, c’est la région du Sahara la plus septentrionale. Seule une petite partie se trouve sur le territoire du Sahara. Sa population est de 434 000 habitants, soit 1,28 % de la population nationale. Sa capitale est Guelmim (200 000 habitants). Les principales ressources traditionnelles du Sahara marocain sont le pastoralisme, la pêche et l’extraction de phosphate dont les réserves sont concentrées autour de Boukraa, à 100 km au sud de Laayoune. Grâce aux efforts colossaux consentis depuis 1999 par les pouvoirs publics marocains dans le domaine des infrastructures (réseau routier, installations portuaires et réseaux d’électricité et d’eau) le tourisme, le secteur agro-alimentaire d’agrumes et légumes, sont devenues des activités essentielles pour l’économie régionale.
Le développement économique et social est devenu une réalité comme ont pu constater les différentes délégations d’opérateurs économiques et hommes politiques étrangers lors de leurs visites sur place au cours de ces dernières années.
La population du Sahara marocain est majoritairement composée de Sahraouis, un groupe ethnique partageant une culture distincte. Les Sahraouis parlent le hassanya, un dialecte arabe, et possèdent des traditions et des coutumes uniques. La musique sahraouie, faisant notamment appel à des instruments traditionnels tels que le tidinit (luth à quatre cordes) et le tbal (tambour), constitue un élément central de leur patrimoine culturel.
L’Espagne se retire du Sahara qui connaît le 6 novembre 1975 une épopée qui restera gravée dans la memoire nationale et subjuguera les observateurs étrangers : La Marche Verte. Un coup de génie de feu Hassan II qui dans un discours historique demande à son peuple de se rendre dans ce territoire libéré cher aux Marocains. Le 16 novembre 1975, la déclaration de Madrid est signée entre l’Espagne, la Mauritanie et le Maroc..
Après les années de conflit (1975-1976) et de discussions-négociations sur fond de manœuvres algériennes, le Maroc et le Front Polisario acceptent, le 30 août 1988, la proposition du secrétaire général de l’ONU d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental. C’est dans ce cadre qu’est créée, en 1991, la MINURSO, et qu’est obtenu un cessez-le-feu toujours en vigueur. Mais le référendum d’autodétermination s’avère comme « impraticable » par de nombreux acteurs qui le juge obsolète et inapplicable. Le principal blocage réside le désaccord historique sur les listes électorales, qui a rendu le processus impossible à mettre en œuvre. Après la publication par la MINURSO d’une liste provisoire de 80 000 personnes habilitées à participer au référendum, 130 000 dossiers de recours sont déposés. À partir de février 2000, devant l’impossibilité de mettre en œuvre le référendum, le secrétaire général de l’ONU privilégie progressivement la voie du règlement politique négocié. Il demande à M. James Baker, envoyé spécial du Secrétaire général, de se rendre dans la région afin d’étudier les moyens de parvenir à un règlement rapide.
Les différentes propositions de règlement conçues dans le cadre des Nations Unies – plan de règlement (1988), plans Baker I (2001) et II (2003) – ayant échoué, le constat s’impose au début des années 2000 : le dossier est dans l’impasse. Le 11 avril 2007, le Maroc présente au secrétaire général des Nations Unies une proposition de plan d’autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara. Dès lors, l’ONU, dans ses résolutions récentes, appuie l’idée d’une solution politique basée sur la proposition marocaine d’autonomie jugée sérieuse et crédible, plutôt qu’un référendum qui ne sera plus mentionné comme base de règlement. Une nouvelle dynamique s’installe autour du dossier avec l’accroissement du consensus international autour de la fiabilité du plan marocain qu’une diplomatie royale sereinement clairvoyante a su démontrer.
Avis consultatif de la Cour internationale de justice de la Haye (16 octobre 1975)
À la demande de l’assemblée générale de l’ONU, la Cour a reconnu qu’un lien d’allégeance existait concernant l’ancien Sahara marocain. En effet, elle a estimé que :
– le Sahara n’était pas avant la colonisation espagnole « un territoire sans maître » ou terra nullius,
– le Sultan et les tribus nomades avaient «des liens juridiques » reconnus, d’ailleurs, par d’autres États.