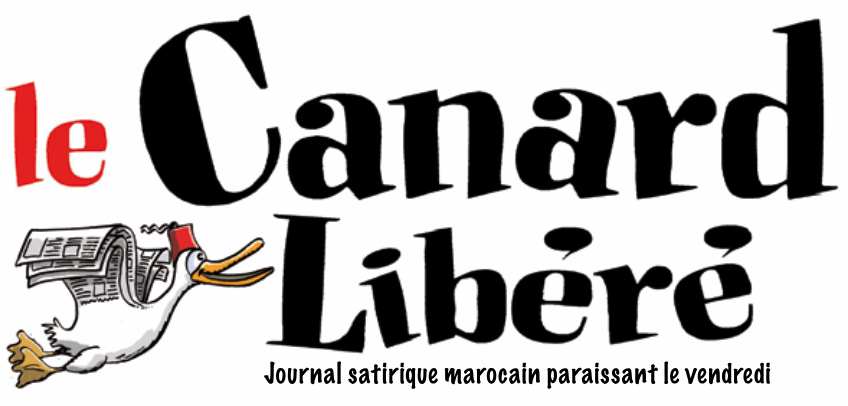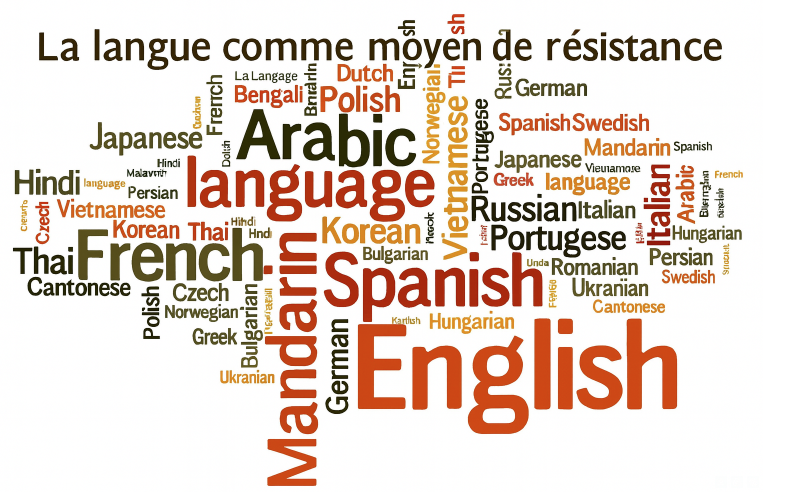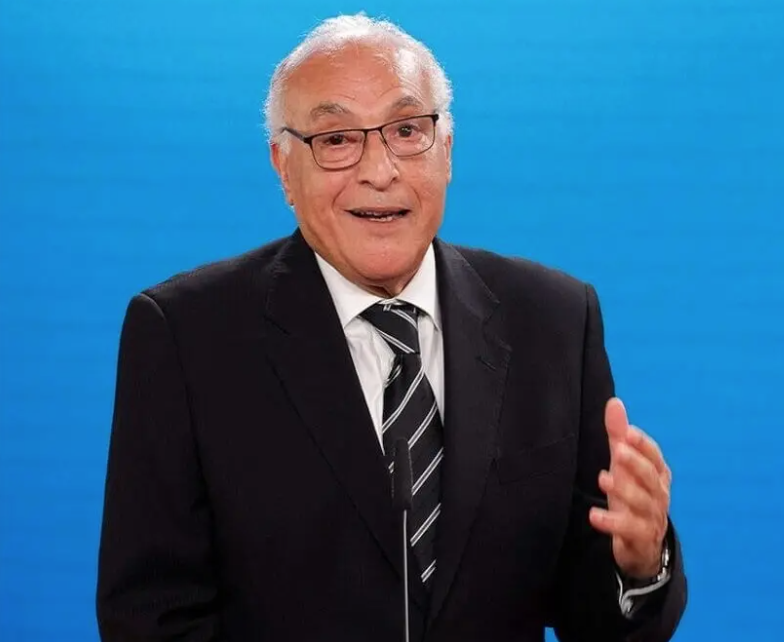Mouloud Benzadi *
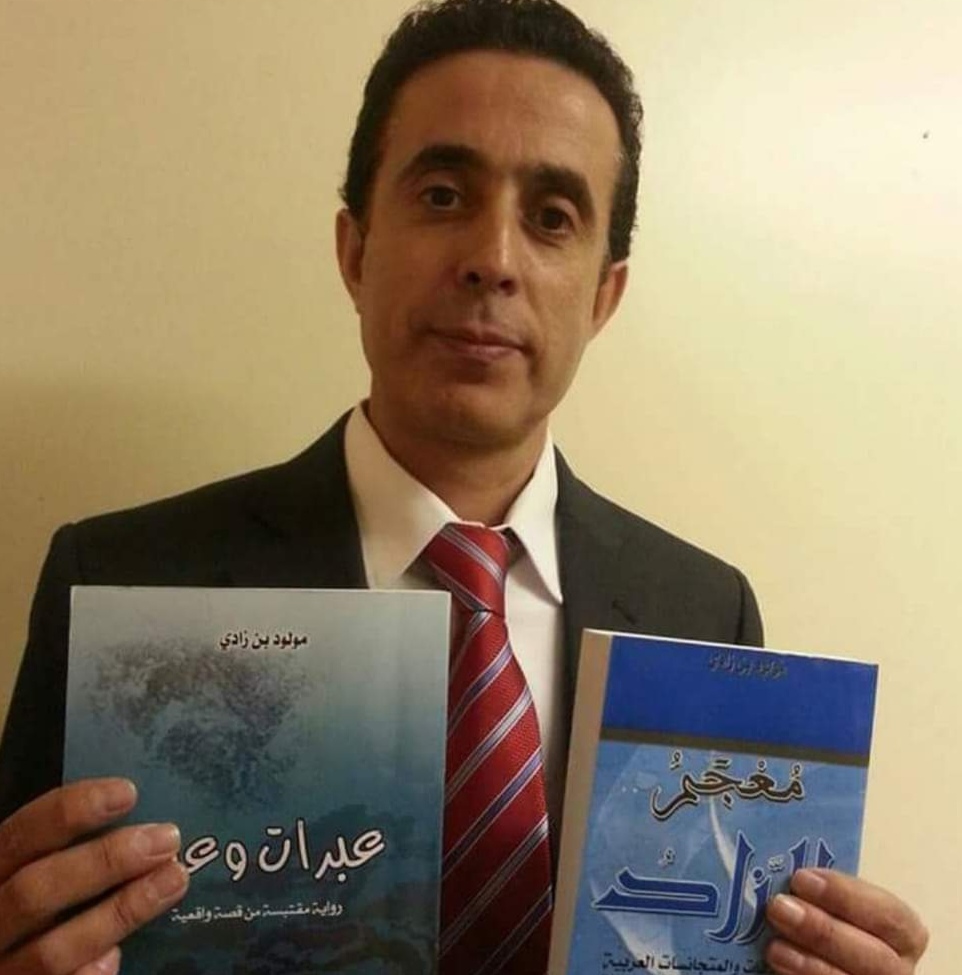
La guerre à Gaza — la plus longue de l’histoire du conflit israélo-arabe — a provoqué une vague de manifestations à travers le monde: marches de New York a Sydney, mobilisations pro-Palestine sur les campus américains, flottilles d’aide en Méditerranée et convois terrestres par l’Afrique du Nord. En Israël, une forme de protestation particulière est apparue: le boycott de la langue hébraïque par les citoyens arabes.
Cet article examine comment la langue est utilisée comme instrument de résistance dans ce conflit prolongé, les implications sociales du rejet d’une langue dominante, et des exemples historiques où la langue a servi de moyen de boycott et de résistance sous occupation.
Résistance par la langue maternelle
Dans un article intitulé “C’est une forme de boycott: pourquoi ces citoyens palestiniens d’Israël éliminent l’hébreu de leur vie quotidienne”, la journaliste de Haaretz Nagham Zbeedat a montré comment de nombreux Palestiniens citoyens d’Israël, qui parlaient autrefois l’hébreu librement, l’évitent désormais dans les espaces publics. Elle a interviewé Rashid, un ingénieur civil de 28 ans, qui a fortement réduit son usage de l’hébreu.
“Ma mission d’éviter l’hébreu a commencé il y a huit ans. Je le considère comme une forme de boycott”, dit-il. “Il ne devrait pas falloir une guerre à Gaza ou l’annexion de la Cisjordanie pour que nous réalisions l’urgence de préserver notre identité et notre langue.”
Dima, une diplômée de 25 ans en génie civil, s’éloigne elle aussi de l’hébreu : “Je ne suis pas disposée à l’utiliser sauf si c’est absolument nécessaire — ni lors des rassemblements ni avec des amis”, explique-t-elle. “Parler arabe dans les espaces palestiniens”, ajoute-t-elle, “est un acte de résistance culturelle.»
Un commerçant confie: “Je ne parle plus qu’arabe maintenant, même lorsque les clients ne comprennent pas, car je veux qu’ils voient qui je suis.” Un étudiant remarque: “Nous parlions hébreu sur le campus sans y penser. Aujourd’hui, nous sommes prudents. Cela semble dangereux.»
Comme l’a noté Haaretz, ces choix montrent que la guerre touche non seulement les routines et interactions quotidiennes, mais aussi la langue même que les gens utilisent pour s’exprimer et se relier aux autres.
Préserver l’identité culturelle arabe
Les Palestiniens utilisent l’arabe non seulement comme forme de résistance contre la guerre et l’occupation, mais aussi pour sauvegarder leur identité culturelle. Comme l’a indiqué Haaretz, l’usage de l’hébreu parmi les Palestiniens suscite souvent des inquiétudes quant à l’identité et à la préservation culturelle. L’article a souligné que beaucoup considèrent le code‑switching — c’est‑à‑dire l’insertion de mots hébreux dans le discours arabe quotidien — comme un danger majeur risquant d’éroder leur identité.
Ainsi, certains évitent consciemment des termes hébreux courants comme “sababa” (cool/génial), malgré leur omniprésence dans la conversation, estimant que ces mots diluent leur patrimoine linguistique. Un effort délibéré est fait pour maintenir un arabe “pur” au quotidien. Beaucoup préfèrent alterner entre l’arabe et l’anglais plutôt que d’intégrer des expressions hébraïques, l’anglais étant perçu comme moins chargé politiquement et moins menaçant pour leur identité culturelle. Comme le souligne l’article, parler exclusivement arabe — à la maison, avec des amis et dans les espaces communautaires palestiniens — est devenu un acte d’affirmation culturelle et une forme de résistance à l’assimilation.
Le prix économique des boycotts linguistiques
Alors que nombre de Palestiniens choisissent l’arabe plutôt que l’hébreu comme acte de résistance culturelle, cette décision entraîne souvent des conséquences personnelles et professionnelles importantes. Dans une société majoritairement hébréophone, une maîtrise limitée crée des obstacles substantiels à la mobilité économique et complique les démarches administratives essentielles.
Ce défi est particulièrement aigu à Jérusalem‑Est, où de nombreux étudiants palestiniens fréquentent des écoles offrant un enseignement minimal de l’hébreu. En conséquence, des diplômés — y compris universitaires — peinent fréquemment à rivaliser sur le marché du travail dominé par l’hébreu à Jérusalem‑Ouest et se voient souvent cantonnés à des emplois faiblement rémunérés, comme le service en restauration, restant gravement sous‑employés au regard de leurs qualifications.
En plus de restreindre les opportunités, l’écart linguistique expose les Palestiniens à l’exploitation. Un responsable communautaire de Jérusalem a décrit comment des femmes ayant une faible maîtrise de l’hébreu ont été induites en erreur et acceptaient des emplois dans des conditions abusives, incapables de saisir pleinement les termes de leur contrat. Le choix de rejeter l’hébreu, aussi significatif soit‑il comme acte de préservation culturelle, impose donc un coût lourd et souvent douloureux à celles et ceux qui tentent de naviguer dans la vie quotidienne.
La résistance irlandaise par la langue
La lutte des Irlandais contre la domination britannique montre comment la langue devint une arme de résistance. Pendant des siècles, l’anglais fut imposé comme langue de pouvoir, tandis que l’irlandais (gaélique) était réprimé. Des lois comme les Statutes of Kilkenny (1367) visaient à l’éradiquer, mais les communautés refusèrent de laisser disparaître leur langue.
Comme l’a montré Patricia Kachuk dans “A Resistance to British Cultural Hegemony: Irish-Language Activism in West Belfast”, le militantisme en faveur de l’irlandais s’est développé à la fois comme renaissance culturelle et comme résistance politique. Lors des grèves de la faim de 1981, des prisonniers républicains se sont auto-enseigné l’irlandais en prison — un acte qui, selon Kachuk, fit de la langue une “expression distinctive de l’identité culturelle et forme de résistance culturelle”.
La résistance prit aussi forme en 1971, lorsque des militants de l’Ouest de Belfast ouvrirent la première école primaire avec un enseignement intégral en irlandais à Shaws Road. En 1991, près de 1000 élèves fréquentaient l’enseignement en irlandais, de la maternelle à un nouveau lycée.
Les résultats furent impressionnants: à Belfast, les locuteurs de l’irlandais passèrent de 7 900 au recensement de 1911 (2,3 %) à 30 000 en 1991 (10 %). Une enquête de 1985 révéla que 86 % des apprenants étudiaient l’irlandais “pour renforcer mon identité irlandaise”. La parole quotidienne devenait une déclaration de dignité. À l’instar des Palestiniens qui privilégient l’arabe, les irlandais firent de leur langue maternelle un instrument de défi.
Les pays baltes: la langue comme libération nationale
L’expérience de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sous la domination soviétique illustre comment la langue servit à la fois de bouclier identitaire et d’outil de libération. Annexées après la Seconde Guerre mondiale, ces nations disposaient déjà de langues nationales établies — estonien, letton et lituanien — dans l’administration, l’éducation et la culture. Leur entrée tardive dans l’URSS signifia que, malgré des décennies de russification, les peuples baltes gardèrent des fondations linguistiques plus solides que bien d’autres républiques. La langue devint un champ de bataille dans les années 1980, à mesure que les mouvements d’indépendance gagnaient en force. En Estonie, la Loi sur la langue de 1995 imposa que toute communication avec l’administration se fasse en estonien, obligeant les non‑locuteurs à payer leurs propres interprètes. En Lettonie, la législation des années 1990 réduisit l’enseignement en russe et confirma le letton comme unique langue officielle. Plus homogène, la Lituanie adopta une voie plus sereine mais décisive, avançant vers un monolinguisme lituanien avec un fort soutien populaire. La politique de citoyenneté accentua cette orientation: tandis que la Lituanie l’accordait automatiquement à tous les résidents, l’Estonie et la Lettonie la lièrent au statut d’avant 1940, obligeant nombre d’immigrés soviétiques à réussir des examens de langue pour se naturaliser. Ces mesures furent de véritables actes de résistance culturelle. Après des décennies de domination russe, protéger les langues nationales devint une déclaration de souveraineté et un moyen pour les Baltes de préserver leur dignité et d’affirmer leur nation.
La langue est plus que des mots
La langue n’est pas seulement un système de communication composé de sons, de mots et de grammaire, comme la définit le Cambridge Dictionary; c’est un univers de sens. Elle incarne la mémoire, la culture, l’identité et la capacité d’exister — ou de disparaître. Des Palestiniens qui boycottent l’hébreu, aux militants irlandais qui ravivent le gaélique, jusqu’aux pays baltes qui réaffirment leurs langues nationales, l’histoire nous enseigne que les guerres ne se mènent pas qu’avec des armes. En temps de conflit ou d’occupation, la langue devient une arme redoutable: chaque mot prononcé dans la langue maternelle dépasse les limites de la parole ordinaire pour devenir un instrument de boycott et de résistance, une quête d’expression de soi, de libération et de survie, et une déclaration d’autodétermination, de liberté et d’indépendance.
* auteur, lexicographe et chercheur – Royaume-Uni