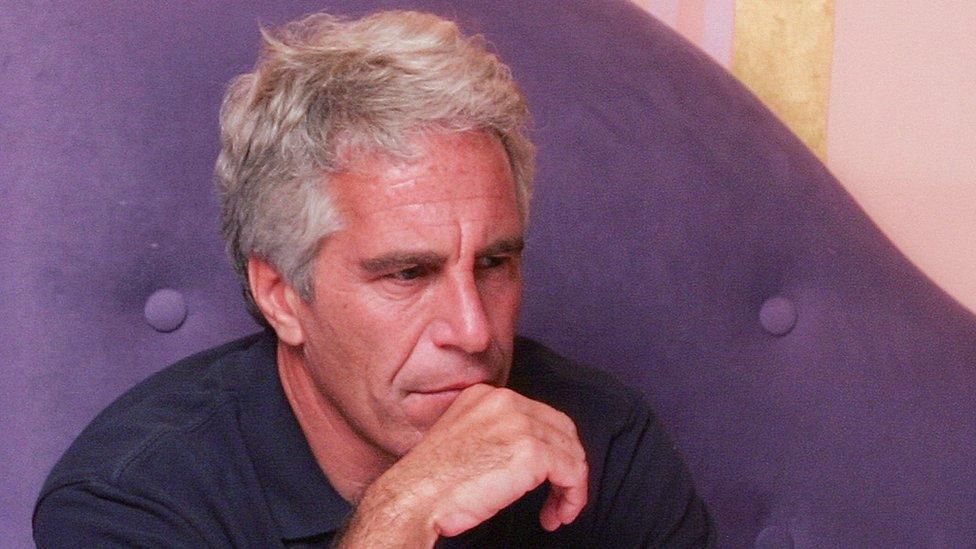Mouloud Benzadi *

Dans mon article intitulé « La face cachée d’un lauréat du prix Nobel : le profond pessimisme de László Krasznahorkai », j’ai souligné le fait qu’il demeurait largement méconnu dans une grande partie du monde. Andrew Ervin a fait le même constat dans son article « Est-ce la toute première critique en anglais de László Krasznahorkai? », publié dans le Philadelphia City Paper et repris par Literary Hub. Comme l’a observé Ervin, « peu d’écrivains [hongrois] ont été traduits et encore moins ont bénéficié d’une quelconque visibilité ici, dans le Nouveau Monde ». Il a mis en lumière le défi posé par la langue hongroise, qu’il décrit comme « parmi les plus uniques et les plus inaccessibles au monde », une réalité qui a limité la portée internationale de sa littérature. De tels obstacles expliquent en partie pourquoi un écrivain de l’envergure de Krasznahorkai est resté peu connu hors de son pays jusqu’à l’obtention du prix Nobel.
La traduction crée une œuvre nouvelle dans une autre langue
Krasznahorkai soutient fermement que la traduction ne peut jamais refléter l’œuvre originale. Selon lui, une traduction ne reproduit pas le livre de l’auteur, mais en crée un nouveau, appartenant au traducteur. Cette conviction est d’autant plus frappante que son œuvre a été publiée dans plus de vingt langues. Dans un entretien, il a déclaré que croire qu’une traduction puisse être assimilée à l’original relève de l’« absurdité ». Le texte dans une autre langue est « l’œuvre du traducteur », une création distincte qui ne ressemble à l’original que comme des parents éloignés. L’original demeure indissociable de sa langue maternelle, façonnée et entendue intérieurement par l’auteur.
Il a illustré ce processus de manière frappante, s’imaginant placer son manuscrit dans un compartiment secret d’un cloître scellé. Le mécanisme tourne à l’abri des regards et, bien plus tard, la traduction apparaît. Il ignore ce qui s’est produit à l’intérieur, quels choix ont été faits, ni comment ses phrases ont survécu. Il a admis qu’il n’a « aucune idée » de la façon dont ses livres sonnent dans d’autres langues, le rythme et le souffle du hongrois ne pouvant être transportés. Le traducteur doit construire quelque chose de nouveau, créant non pas une copie, mais une œuvre parallèle qui tient debout par elle-même.
Pourquoi une traduction parfaitement fidèle est impossible
La véritable littérature est une fusion entre génie linguistique et culture unique, que la traduction ne peut pleinement reproduire. Il n’existe aucun substitut à la lecture d’un texte dans sa langue d’origine. Ceci est particulièrement vrai pour des langues comme le hongrois, appartenant à une famille distincte (finno-ougrienne). Cette différence fondamentale rend une traduction réellement exacte presque impossible. Krasznahorkai souligne l’unicité de sa langue : sa complexité et son élasticité — sa capacité à former des structures longues et spiralées. Le hongrois, agglutinant, permet d’agencer les propositions avec une grande liberté, déployant une phrase dans un flux continu reflétant le mouvement de la pensée. Cette souplesse donne à son écriture son rythme caractéristique, une musique intérieure liée à la langue. Le français, bien qu’il offre une certaine flexibilité, est plus contraint que le hongrois. Il exige une syntaxe cohérente, des phrases clairement segmentées et un ordre des mots relativement fixe. Il ne peut reproduire la même longueur ou fluidité du hongrois sans risque de lourdeur ou de perte de sens. Les traducteurs doivent donc déconstruire et remodeler sa prose selon les formes du français. Même les plus talentueux prennent des décisions interprétatives qui éloignent le texte de sa source. Le résultat n’est pas un miroir, mais une recréation habile, limitée par une autre langue. Ces différences structurelles expliquent pourquoi la traduction ne peut offrir une représentation fidèle de l’intention ou du style lorsque les langues reposent sur des principes si divergents.
Les lauréats du prix Nobel alertent sur les limites de la traduction
László Krasznahorkai n’est pas le seul lauréat du Nobel à souligner les limites de la traduction. D’autres lauréats ont également réfléchi à la manière dont le sens, le rythme et l’intention se transforment lorsqu’une œuvre franchit les frontières linguistiques.
Joseph Brodsky (Nobel 1987) avertissait que la traduction ne pouvait préserver la musique de sa poésie russe. Il estimait que le rythme et l’architecture d’un poème sont liés à sa langue d’origine. Brodsky pratiquait l’auto-traduction, non pour refléter l’original, mais pour le reconstruire en anglais, acceptant que le résultat soit nécessairement une œuvre différente. Annie Ernaux (Nobel 2022) a exprimé sa propre inquiétude : « cela me gêne de voir que cela a été simplifié et que les significations ont été réduites ». Son propos fait écho à la lutte de nombreux auteurs dont la voix repose sur des nuances souvent perdues. Associés aux réflexions de Krasznahorkai, ces témoignages révèlent un constat clair : même parmi les écrivains les plus célébrés, il existe une conscience partagée que la traduction, aussi attentive soit-elle, ne peut jamais reproduire pleinement l’original.
L’avertissement de la Renaissance : « Traduttore, traditore »
Ces préoccupations mettent en lumière une réalité souvent négligée : la traduction trahit la littérature. L’idée que la traduction trahit l’original est bien plus ancienne que les débats modernes. Bien que des écrivains contemporains comme László Krasznahorkai s’expriment sur l’impossibilité de transporter intact un texte dans une autre langue, cette crainte plonge ses racines dans l’histoire. Depuis des siècles, on reconnaît que quelque chose d’essentiel se perd lorsqu’une œuvre change de monde linguistique. Cette inquiétude se cristallise dans le proverbe italien : « Traduttore, traditore » (Traducteur, traître). Apparu à la Renaissance, il reflète la conviction que toute traduction altère inévitablement l’original. L’expression est devenue fondatrice, influençant les premières réflexions sur la fidélité et les limites de l’équivalence.
De grands écrivains et penseurs ont repris cette même inquiétude. Borges a écrit sur la manière dont les traductions transforment un texte. Walter Benjamin soutenait qu’une traduction ne peut reproduire « l’essence » de l’original. Umberto Eco observait que « le traducteur négocie le sens », reconnaissant l’empreinte de son interprétation. Haruki Murakami, à la fois romancier et traducteur, a admis que les œuvres traduites portent inévitablement un rythme et une voix différents. Même dans la littérature contemporaine, cette idée persiste. Salman Rushdie a souvent réfléchi à la manière dont les récits changent en franchissant des frontières linguistiques. Sans avoir forgé l’expression, il reconnaît que le sens narratif se déplace, devenant une création nouvelle façonnée par les choix du traducteur.
Vers une langue littéraire universelle : un constat qui s’impose
Le parcours qui mène de l’adage de la Renaissance aux réflexions des lauréats du Nobel est sans équivoque : la traduction ne préserve pas un texte, elle le transforme. Chaque œuvre traduite est un palimpseste, portant à la fois la trace de l’original et la marque indélébile du traducteur. Ironiquement, ce processus de transformation n’est pas sans rappeler celui opéré par l’IA pour reformuler un texte. Pourtant, un double standard persiste : les œuvres traduites — dont la voix est souvent celle de leur traducteur — sont couronnées par les grands prix littéraires, tandis que l’usage de l’IA, pour une tâche similaire dans son essence, soulève de vives controverses.
Les difficultés de la traduction, surtout avec des langues très différentes comme le hongrois, sont considérables. Les erreurs, les imprécisions et la perte de la beauté du style sont toujours possibles, même pour un traducteur expérimenté. Basé sur mon expérience de traducteur qualifié, travaillant au Royaume-Uni, je peux témoigner que reproduire parfaitement le sens, le rythme et l’esprit d’un écrivain dans une autre langue est en réalité impossible. Face à cette équation impossible, une perspective radicale émerge: et si l’avenir de la littérature mondiale passait par l’adoption d’une lingua franca ? Il serait peut-être plus sage d’envisager un modèle où les œuvres écrites directement dans une langue commune, l’anglais, deviendraient la norme pour les jugements internationaux.
José Saramago soulignait le paradoxe : « Les écrivains créent une littérature nationale avec leur langue, mais la littérature mondiale est écrite par les traducteurs. » Pourtant, au regard de l’inévitable attrition causée par la traduction — la voix originale, le rythme unique, les nuances culturelles — une conclusion s’impose. Je soutiendrais que : « La littérature mondiale n’est pas une littérature traduite. La littérature mondiale est écrite directement dans la langue globale. » En d’autres termes, « la littérature mondiale ne naît pas d’une langue nationale maîtrisée par quelques-uns, mais de la langue du monde — une langue que toute l’humanité peut comprendre, et qu’il nous appartient collectivement d’apprendre, de nourrir et de défendre. »