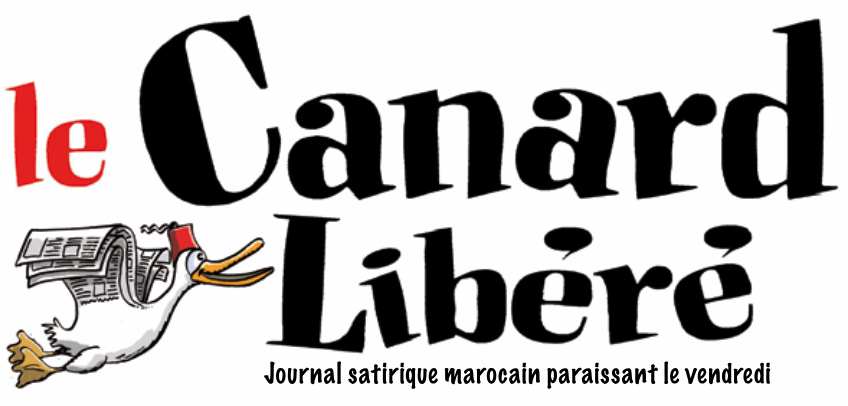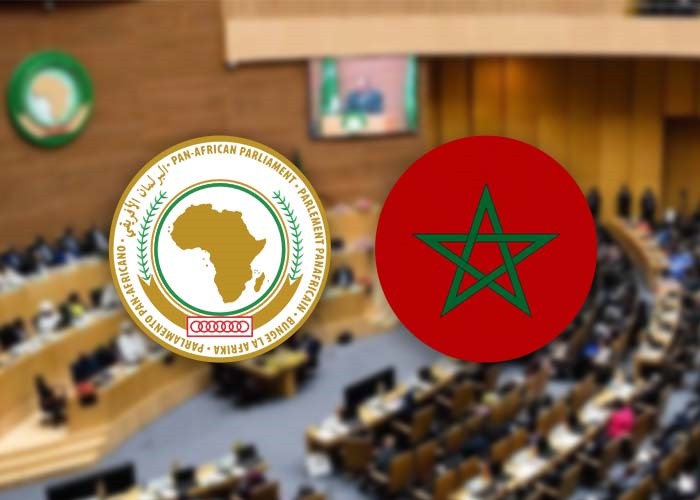Président du Centre Marocain pour la Citoyenneté (CMC), Rachid Essedik livre au Canard Libéré son regard sur les valeurs et aspirations de la jeunesse marocaine. Entre quête d’autonomie, besoin de reconnaissance et engagement souvent cantonné aux réseaux sociaux, il déplore le manque d’espaces et de relais capables de transformer ces dynamiques en véritable participation citoyenne.
Propos recueillis par Jamil Manar
D’après vous, quelles sont aujourd’hui les valeurs dominantes qui guident la jeunesse marocaine ? Ont-elles évolué ces dernières années ? Et dans quel sens ?
Rachid Essedik : Je pense que l’une des valeurs les plus marquantes chez les jeunes marocains, c’est l’affirmation de soi. Ils aspirent à plus d’autonomie, à faire leurs propres choix, à réussir par leurs propres moyens. Ce besoin de liberté individuelle et de reconnaissance personnelle est devenu très présent, notamment grâce à l’accès élargi à l’information, aux réseaux sociaux et à une ouverture sur le monde. L’individualisme, dans ce contexte, n’est pas un repli, mais souvent une manière pour les jeunes de se construire une identité propre, en dehors des cadres classiques.
Il est vrai aussi qu’une partie de cette jeunesse recherche des voies plus rapides pour atteindre ses objectifs. Cela ne veut pas dire qu’elle rejette l’effort, mais plutôt qu’elle est en quête d’efficacité et de résultats concrets. Ce pragmatisme s’explique par un environnement souvent marqué par des obstacles sociaux, économiques et institutionnels.
En parallèle, beaucoup de jeunes restent attachés à des valeurs de respect, de justice et de solidarité, même si ces valeurs s’expriment parfois différemment d’une génération à l’autre. On voit émerger des engagements locaux, culturels ou associatifs qui montrent que l’individualisme peut coexister avec une volonté d’agir pour le bien commun.
Oui, les valeurs ont évolué vers plus d’autonomie et de liberté, mais avec des inégalités fortes à prendre en compte. Le vrai défi est d’aider chaque jeune à trouver sa place dans la société, quels que soient ses moyens de départ.
De nombreux jeunes semblent en quête de sens, de reconnaissance, parfois de repères. Quelles réponses la société marocaine leur offre-t-elle aujourd’hui pour canaliser leurs énergies et nourrir leur engagement citoyen ?
Cette quête de sens, de reconnaissance et de repères est bien réelle. Malheureusement, la société n’apporte pas toujours des réponses à la hauteur. Il existe certes des initiatives intéressantes — associatives, culturelles, ou participatives — mais elles restent limitées en portée et souvent inaccessibles à une majorité de jeunes.
Dans ce vide, les jeunes investissent les réseaux sociaux comme espace d’expression. Ils y débattent, lancent des causes, interpellent les décideurs. C’est une forme d’engagement nouvelle, directe, mais qui reste souvent sans lien avec le terrain ou les politiques publiques. Résultat : beaucoup expriment leur opinion, mais ont le sentiment de ne pas être réellement entendus ou impliqués.
Pour répondre à cette attente, il faut bâtir un écosystème d’engagement plus souple, plus inclusif, et plus proche du terrain. Et cela suppose de valoriser les initiatives des jeunes, d’écouter leurs propositions, et de leur faire une vraie place dans la vie publique. C’est un chantier national.
Quel rôle joue, ou devrait jouer, le système éducatif marocain pour accompagner les jeunes dans la construction de leur identité citoyenne, dans un contexte social de plus en plus complexe ?
L’école reste l’un des rares espaces capables de toucher tous les jeunes, sur tout le territoire. À ce titre, elle devrait être un véritable levier de formation citoyenne. Mais aujourd’hui, cette dimension est souvent reléguée au second plan, derrière les exigences scolaires et les examens.
Des efforts existent, bien sûr : clubs de citoyenneté, actions ponctuelles, enseignants engagés… Mais tout cela reste trop fragile et inégal. Il faut intégrer la citoyenneté dans la vie quotidienne des établissements, à travers des projets, des débats, des espaces d’expression. C’est ainsi qu’on apprend le respect, le dialogue, la différence. Dans un monde où les jeunes sont exposés à des discours parfois contradictoires et violents, l’école a un rôle clé pour leur donner des repères, cultiver leur esprit critique, et renforcer leur confiance dans les institutions.
On parle souvent d’un déficit d’encadrement des jeunes en dehors de l’école : famille, quartier, associations… À quel point ce manque de relais éducatifs contribue-t-il à une fragilisation des repères et à des comportements de rejet ou de violence ?
Oui, c’est un constat que nous faisons régulièrement. En dehors de l’école, beaucoup de jeunes ne bénéficient pas d’un encadrement régulier. Dans certaines familles, le lien éducatif est affaibli, voire inexistant — souvent par manque de temps, de moyens, ou de capacité à suivre les réalités actuelles.
Dans les quartiers, les associations ou espaces culturels sont souvent trop peu nombreux, ou mal dotés. Ce vide crée une vulnérabilité. Quand les jeunes n’ont pas de cadres bienveillants autour d’eux, ils se tournent vers d’autres sources d’influence : parfois positives, mais aussi parfois dangereuses — discours de haine, radicalité, isolement. Il est donc essentiel de revaloriser les acteurs de proximité, mais aussi d’utiliser intelligemment les réseaux sociaux comme levier éducatif. Ces plateformes font partie du quotidien des jeunes : il faut y être présents, avec des messages clairs, crédibles, et adaptés à leur langage.
On observe une montée préoccupante des propos hostiles envers les migrants subsahariens, notamment sur les réseaux sociaux. À votre avis, cela traduit-il une évolution inquiétante dans les valeurs portées aujourd’hui par une partie de la jeunesse marocaine ?
Ces discours hostiles sont effectivement préoccupants, mais ils ne signifient pas forcément que la jeunesse marocaine a perdu ses valeurs. Ils révèlent surtout un mal-être, un vide éducatif, et parfois une réaction défensive dans un contexte de tensions sociales et économiques. Certains jeunes, en difficulté, peuvent voir dans l’autre — en particulier le migrant — un rival ou un bouc émissaire. Mais cette perception est souvent construite sur des idées fausses. Le rôle des adultes, des éducateurs, et des médias est justement de déconstruire ces récits.
Les réseaux sociaux amplifient souvent les discours les plus extrêmes, au détriment des nombreuses expériences positives de cohabitation et de solidarité que l’on retrouve sur le terrain. Il est urgent de reconstruire une culture du respect et du dialogue, à travers l’école, les médias, les familles, les associations… et bien sûr les réseaux sociaux, où se forgent aujourd’hui les représentations des jeunes.
Le système éducatif marocain prépare-t-il réellement les jeunes à vivre dans une société ouverte, marquée par la diversité culturelle ? Où se situent, selon vous, les principales lacunes ?
Et au-delà de l’école : quel rôle jouent — ou devraient jouer — les médias, les réseaux sociaux, les familles et les institutions religieuses dans la transmission des valeurs de tolérance et de respect de l’autre ?
Il y a clairement une prise de conscience progressive au sein de l’école marocaine de l’importance de former les jeunes à vivre dans une société diverse. On voit apparaître des programmes de sensibilisation aux droits humains, des clubs scolaires autour de la citoyenneté, et certaines initiatives d’ouverture à l’interculturel.
Mais ces efforts restent encore limités, inégaux, et souvent dépendants de la motivation personnelle de certains enseignants ou responsables.
Mais l’école ne peut pas porter cela seule. Les familles doivent transmettre des valeurs de respect dès le plus jeune âge.
Les médias doivent sortir des logiques de sensationnalisme et donner de la visibilité aux récits positifs de diversité.
Les réseaux sociaux doivent être investis avec intelligence et créativité. Et les institutions religieuses ont un rôle important à jouer dans la promotion de discours de paix, de fraternité et de vivre-ensemble. La transmission des valeurs de tolérance ne peut pas être un effort isolé : c’est une chaîne continue, qui va de la maison à l’école, en passant par la rue, la culture et l’écran.