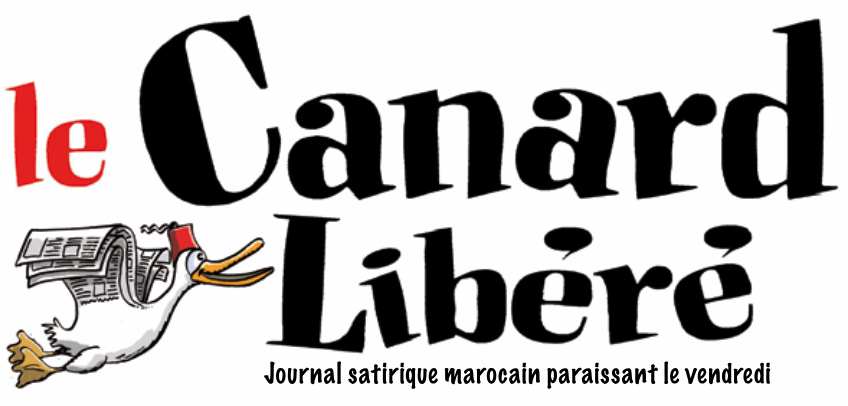Nous célébrons le centenaire de Khouribga et de l’OCP, l’Office Chérifien des Phosphates voulu par Lyautey. Jnaynar Lotti, comme le nomment les indigènes des Ouled Abdoun, en signant le décret du 27 janvier 1920, est conscient du caractère exceptionnel de l’Office, prononcé « Loufisse » par les autochtones, et décide d’en confier l’exploration et l’exploitation au seul « Magasin » (ma5zen) afin d’éviter la rapacité du secteur privé. Lyautey va être stoppé net par la première Guerre mondiale 1914-1918. L’entrée en guerre de la France implique de la part du Maroc un effort particulier pour la soutenir, d’abord par l’envoi de troupes, les fameux goumiers « Zidou L’goudam!» (« marchez en avant ! » en Marocain), ensuite par des fournitures agricoles massives pour pallier les déficits nés de l’occupation d’une partie de la France par les Teutons et du manque de bras des paysans partis mourir dans les tranchées, galvanisés par un fervent nationalisme anti-Teuton. Les paysans français partaient à l’abattoir en chantant à gorge déployée le tube de l’été: « O vous les Boches ! Têtes de pioches ! Gare à vos carcasses ! Voici la vingtième qui passe ! ». Les chiffres de l’aide envoyée par le Maroc pour une guerre qui ne le concernait pas sont éloquents : 100 000 quintaux de blé en 1915, 235 000 quintaux de blé en 1916, plus encore pour l’orge et la laine… Lyautey s’engage à aider, sans dégarnir le pays et sans se replier sur la côte comme le lui demandent les politiciens parisiens, mais ils le laissent faire, occupés qu’ils sont à se battre contre leurs propres Chleuhs.
Lyautey savait en effet le risque d’embrasement qui pourrait suivre le retrait total des troupes au contact des rebelles de Taza et de Khénifra. Il adopte donc la stratégie de la « coquille d’œuf » : une armature légère pour donner l’impression que les forces sont toujours là. Les politiciens parisiens occupés à s’auto-suicider avec les Allemands, laissent plus de liberté à Lyautey pour mener à bien ses projets architecturaux. La bureaucratie française si tatillonne relâche son contrôle et cède sans discuter le Maroc à Lyautey. 3afrite (عفريت malin en arabe), Jnaynar Lotti retrouve ses plaisirs d’enfant lorsqu’il construisait des maisons dans son bac à sable à Nancy. Il donne son meilleur à son bébé Rabat. Après avoir décidé d’abandonner Fès et de choisir Rabat comme nouvelle capitale du Maroc, il tombe littéralement amoureux de cette ville. A Rabat, l’ingrate, il n’a pas de statue, même pas une rue à son nom. Pourtant, cette enfant ingrate lui doit beaucoup. Il est le sauveur de la 9asbah des Oudayas. Il s’entoure d’une équipe d’architectes, d’urbanistes et de chargés des plans et se fait plaisir à Rabat (à partir de 1914) et à Casablanca (à partir de 1917). Poète à ses heures, féru d’architecture, c’est un personnage complexe et attachant, érudit, coléreux, bourré de contradictions. Alors qu’il est militaire, il ose prendre la défense du capitaine Dreyfus. Catholique fervent, il confesse son admiration pour la religion musulmane.
Aristocrate dans l’âme, il possède une vraie fibre sociale. Royaliste assumé, il sert la République. Lyautey respecte la médina, le cœur de la ville et met en valeur les monuments anciens : il dégage et met en perspective la tour Hassan à Rabat. Elle apparaît en point de mire de plusieurs perspectives ; et des rives du Bou Regreg, le fleuve qui s’alanguit dans l’Océan, la vue reste intacte sur les remparts de Salé… A Rabat, il conçoit les jardins de l’actuel ministère de l’Intérieur, l’actuel Parlement, la Poste, la Gare et la Cathédrale Saint-Pierre de Rabat aux tours en forme de minaret. Il impose à son équipe de « toucher le moins possible aux villes indigènes » et, surtout, de respecter les symboles. Ainsi, l’artère principale de la nouvelle capitale du royaume – l’actuelle avenue Mohammed-V – s’inscrit dans le prolongement d’une importante rue commerçante de la médina « Bab El7ad » et file dans l’axe jusqu’à la mosquée Alsouna. A suivre)