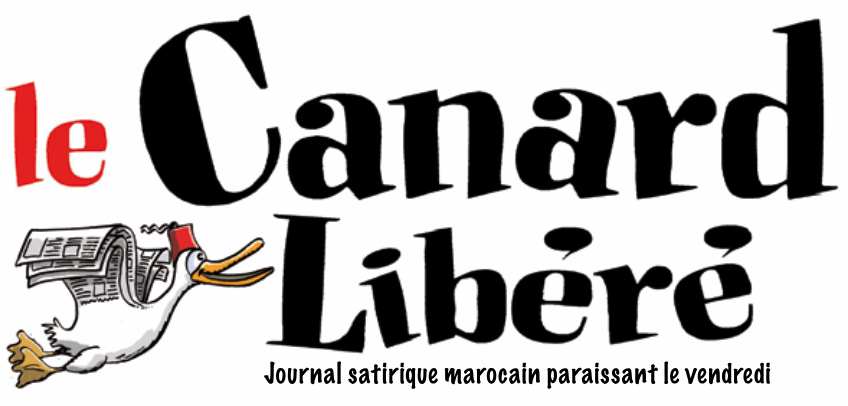Nous célébrons le centenaire de la ville de Khouribga et de l’OCP, l’Office Chérifien des Phosphates voulu par Lyautey. ‘‘Jnaynar Lotti’’, comme le nommaient les Ouled Abdoun, en signant le décret du 27 janvier 1920, était le seul à être conscient du caractère exceptionnel de ce ‘‘Loufisse’’. En confiant l’exploration et l’exploitation de l’OCP au seul ‘‘Magasin’’ (ma5zen), Lyautey a ainsi évité la rapacité du secteur privé. Dès juin 1921, la première cargaison de phosphates est transportée à bord du train de Boujniba vers le port de Casablanca. Deux tribus se partageaient la région où fut implantée Khouribga : les Ouled Bahr Lakbar au Nord-Est de la future ville, comprenant les Ouled Brahim, les Gfaf et les Beni Khlef d’une part et les Ouled Bahr Sghar au Sud et à l’Ouest d’autre part, comprenant les Ouled Abdoun, les Fokra, les M’Fassis et les Ouled Azouz. Ces tribus vivaient des cultures céréalières (essentiellement la culture de l’orge et à un degré moindre celle du blé) en plus de l’élevage des ovins. Entre deux récoltes, ces tribus passaient leur temps à se chamailler et à guerroyer. Après la découverte fortuite des phosphates, à l’occasion des travaux de chemin de fer de la ligne Casablanca – Oued-Zem, et le développement très rapide de la ville de 5ribga, la région va se transformer. Les pasteurs nomades se sédentarisent et la culture se généralise. Les colons zéropéens vont développer des cultures maraichères sur les terres les plus fertiles. Madame Mariano, restée célèbre car elle se déplaçait en carriole typique des films western tirée par des chevaux, différente de nos charrettes du bled, va lancer un élevage de porcs très proche des Saintes 3amriattes de Mnina. Les 5amassa (métayers payés avec le 1/5 de la récolte) vont se transformer en zoufria (ouvriers). Le recrutement des zoufria par Loufisse va poser énormément de difficultés aux managers zéropéens car les indigènes étaient très réticents au travail à la mine. Loufisse a d’abord eu recours aux nomades qui devaient fournir quatre jours de travail par an et par homme à leur caïd. Ensuite, Loufisse a fait appel à des prisonniers, condamnés de droit commun. Des travaux forcés en quelque sorte.
Dès les années trente, Loufisse instaura une politique de prospection systématique et de recrutement de la main d’œuvre berbère dans le Sud-Ouest du pays (surtout dans la région d’Agadir). Ce fut d’abord une immigration d’hommes seuls qui voyaient dans le travail à la mine une source de revenus à réinvestir dans la communauté villageoise d’origine. Dans un second temps, Loufisse va s’évertuer à les fixer à 5ribga par l’attribution d’un logement gratuit et des avantages sociaux. Ce qui encouragea beaucoup d’entre eux à s’installer en famille à Khouribga. La présence berbère à dominante Soussi dans la ville va devenir importante et organisée. Ils ne s’intègrent pas à la population locale. Au contraire, on peut dire qu’une certaine animosité va opposer les indigènes à ces chleuhs venus de loin… Comme quoi on peut devenir zmagri dans son propre pays. La diversité culturelle de la ville va s’accentuer quand l’OCP fera appel à une main d’œuvre qualifiée provenant de plusieurs contrées lointaines du bassin méditerranéen et également du Nord de la France : Grecs, Italiens, Maltais, Espagnols, Portugais… Cette hétérogénéité des cultures, si elle s’est trouvée exprimée à la mine, n’apparaissait pas cependant dans la répartition spatiale, résidentielle, des différents groupes. La morphologie urbaine de Khouribga suit deux logiques qui se recoupent : celle de la ville minière et celle de la ville coloniale. La première distingue la ville de l’OCP et la « ville libre », c’est à dire qui ne dépend pas administrativement de la mine. La seconde est celle que l’on retrouve dans les villes.
Une ville typiquement européenne, commerciale, avec sa dépendance résidentielle et administrative ; et une ville de type arabe avec ses trois parties : ancienne et nouvelle médina et bidonvilles. La séparation entre les deux modèles urbains est matérialisée par la voie ferrée qui permet d’acheminer le phosphate vers le port de Casablanca d’où il est exporté. (A suivre)