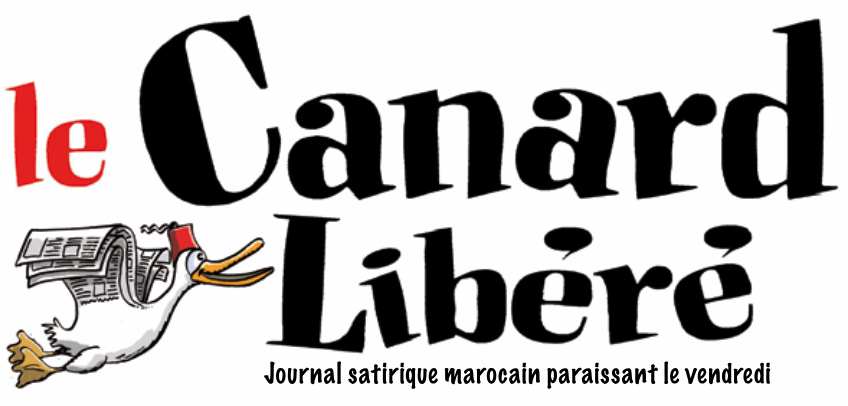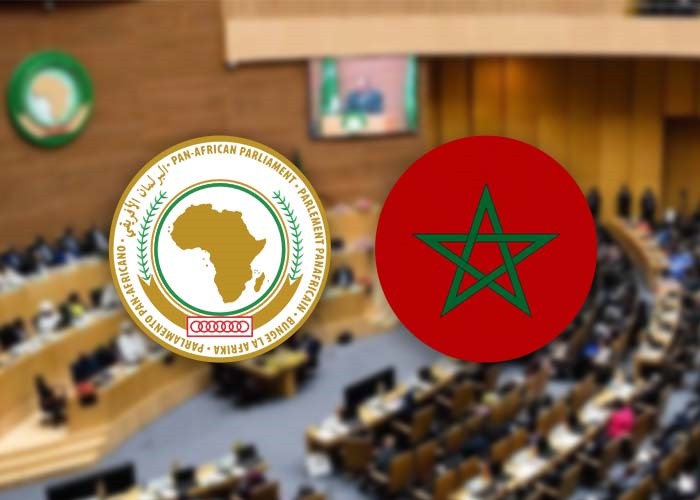Albert Camus, fils d’une femme de ménage andalouse, immigrée dans l’Algérie française, prix Nobel de littérature, à la surprise générale, surtout la sienne. Albert Camus avait alors 44 ans et était le neuvième français à obtenir le prix Nobel. Il dédie son discours à Louis germain, l’instituteur qui en CM2 lui a permis de poursuivre ses études malgré sa pauvreté de fils de femme de ménage andalouse. Catherine Hélène Sintès, mère d’Albert, en partie sourde, ne sait ni lire, ni écrire : elle ne comprend un interlocuteur qu’en lisant sur ses lèvres, n’a qu’un très petit vocabulaire « de 400 mots » et communique en utilisant une gestuelle propre à sa famille, utilisée également par son frère Étienne. « Dépendante et perdue au quotidien, peu écoutée et peu comprise, condamnée aux échanges rudimentaires et banaux, elle est coupée du monde des autres et n’a accès ni à la culture ni au divertissement ».
L’expérience sera douloureuse pour Albert Camus qui ne cessera de questionner ce mutisme terriblement angoissant. D’ailleurs, son œuvre portera toujours la marque de l’indicible, de l’incapacité à dire ou de l’impuissance à faire entendre sa voix. Albert Camus regrette son prix Nobel de littérature. Il aurait souhaité qu’il revienne à André Malraux, son aîné, qu’il considère aussi comme un maître. Le prix lui a été décerné pour « l’ensemble d’une œuvre qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience des hommes ». Albert Camus disait à propos de l’art d’être français : « Ma patrie c’est la langue française ! ». Cette langue réunit les Français car elle est le résultat d’une mosaïque de plusieurs langues régionales : picarde, gasconne, provençale, alsacienne… Ce sont les Rois de France qui ont unifié ce pays par la langue. Après le poète Rutebeuf (XIIIème siècle) nous faisons un saut de 3 siècles au XVIème pour découvrir Ronsard » et son poème « Mignonne, allons voir si la rose ». La mignonne, c’est Cassandre (1530-1607), la fille de Bernardo Salviati, un des banquiers du roi François Ier. Cassandre est rencontrée par le poète le 21 avril 1545 à Blois à un bal de la cour. Elle n’a que 15 ans et lui 21. Ronsard ne pouvait épouser la jeune fille, car il était clerc tonsuré. Cassandre épousa Jean Peigné, seigneur de Pray l’année suivante.
Ronsard fait de Cassandre son égérie, célébrant un amour tout imaginaire dans un style précieux avec comparaisons mythologiques et mignardises : «Mignonne, allons voir si la rose, Qui ce matin avait éclose Sa robe de pourpre au Soleil, N’a point perdu cette vêprée. Les plis de sa robe pourprée, Et son teint au votre pareil. Las ! voyez comme en peu d’espace, Mignonne, elle a dessus la place. Las ! las ses beautés laissé choir! Ô vraiment marâtre Nature, Puisqu’une telle fleur ne dure Que du matin jusques au soir ! Donc, si vous me croyez, mignonne, Tandis que votre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté, Cueillez, cueillez votre jeunesse: Comme à cette fleur la vieillesse Fera ternir votre beauté. ». Voici l’épitaphe que Ronsard a proposé au poète savoisien Marc-Claude de Buttet de graver sur sa tombe : CELUY QUI GIST SOUS CETTE TOMBE ICY. AIMA PREMIERE UNE BELLE CASSANDRE. AIMA SECONDE UNE MARIE AUSSY. TANT EN AMOUR IL FUT FACILE A PRENDRE. DE LA PREMIERE IL EUT LE CŒUR TRANSY. DE LA SECONDE IL EUT LE CŒUR EN CENDRE. ET SI DES DEUX IL N’EUT ONCQUES MERCY.