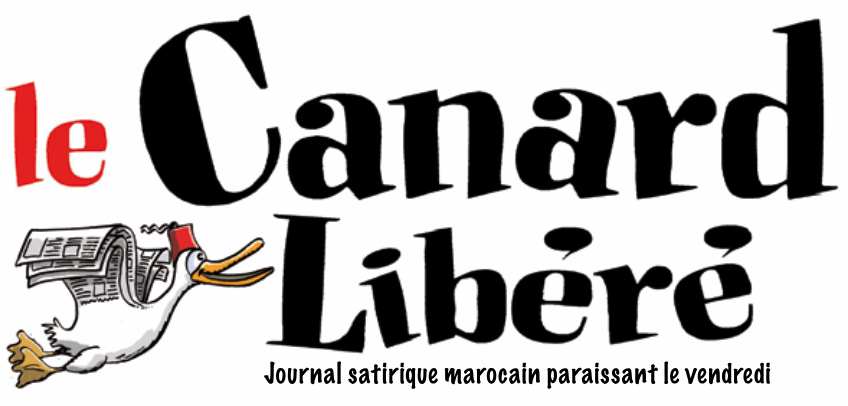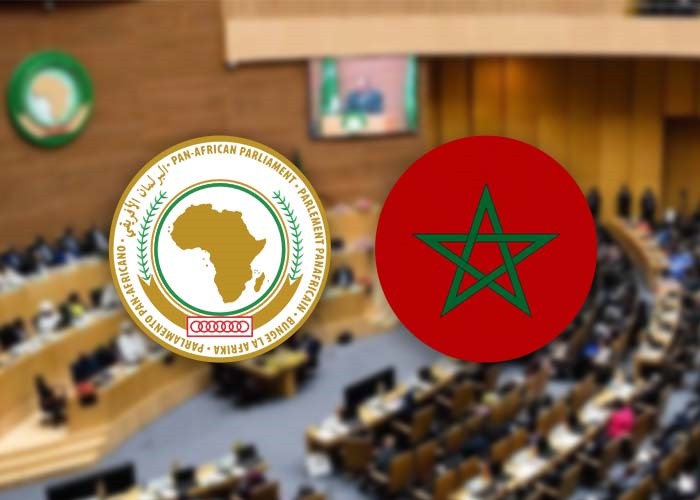L’investissement public a augmenté considérablement enregistrant un taux d’évolution de 86,8 % sur la période 2020-2025, et devrait atteindre 380 MM DH au titre de l’année 2026. Cet effort volontariste d’investissement a pour objectif d’appuyer la réalisation des grands chantiers structurants d’infrastructure, d’accompagner la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles, et d’améliorer l’accès aux services sociaux de base. Ces programmes s’articulent autour des quatre axes prioritaires :
« 1. la promotion de l’emploi à partir des vocations économiques dominantes et des spécificités de chaque territoire ;
2. le renforcement des services sociaux de base pour combler les déficits persistants et améliorer davantage les indicateurs sociaux ;
3. La gestion proactive et durable des ressources en eau pour une utilisation efficiente permettant d’atténuer les effets du stress hydrique ;
4. La mise à niveau territoriale intégrée reposant sur le renforcement des infrastructures et des services de base, tout en s’appuyant sur la dynamique de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde de football 2030. » (Note sur la répartition régionale de l’investissement. PLF 2026).
Une question de méthodologie
Malheureusement, les données telles qu’elles sont présentées dans cette note ne permettent pas une lecture lucide et ne fournissent pas des données précises sur la répartition régionale de l’investissement. On y trouve des données éparses sur les 12 régions. Si on prend l’exemple de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les données sont présentées en 4 tableaux :
-Principaux projets d’investissement publics (Budget Général) achevés en 2024.
– Principaux projets d’investissement publics (Budget Général) en cours d’exécution.
-Principaux nouveaux projets d’investissement publics (Budget Général)
– Principaux projets d’investissement publics (Budgets des EEP)
La même démarche est suivie pour les autres régions. Ainsi présentées, ces données présentent, de notre point de vue, peu d’intérêt et ne permettent pas de procéder à des lectures fécondes en matière de la répartition régionale de l’investissement. La confusion est totale : l’investissement public ne se réduit pas à l’investissement du budget général et à celui des Etablissements et Entreprises publics (EEP). Il faut y ajouter l’investissement réalisé par les CST (Comptes Spéciaux du Trésor) qui n’est pas négligeable, le Fonds Mohamed VI et les collectivités territoriales.
Sur une carte du Maroc, on présente le PIB par habitant et la contribution régionale au PIB pour la période 2015-2023, en agrégeant les données en 4 groupes : les régions Draa Tafilalet, Guelmim Oued Noun, Laayoune sakia Al hamra et dakhla Oued Addahab ont une contribution au PIB variant entre 1-5% ; les régions Souss Massa, Marrakech Safi, Fès-Meknès, Oriental et Beni Mellal -Khénifra y contribuent entre 5 et 10% ; les deux régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rabat-salé-Kénitra y contribuent entre 10-25% ; seule la région Casa-Settat, se détache du lot avec une contribution variant dans une fourchette de 25-32%.
EEP, 64% de l’investissement vont à trois régions
L’analyse de la répartition régionale des investissements prévisionnels des EEP pour les années 2025 et 2026 est plus claire. Elle fait apparaître une forte concentration géographique de l’effort d’investissement public. En 2025, près de 64% de l’enveloppe globale est orientée vers trois régions seulement : Casablanca-Settat (30,6%), Rabat-Salé-Kénitra (19,4%) et Marrakech- Safi (13,6%). Cette tendance se prolonge en 2026 avec des parts respectives de 31,2%, 14,6% et 14,6%, confirmant l’ancrage prépondérant des investissements dans les pôles urbains historiquement mieux dotés en infrastructures et en projets. Si certaines régions à l’instar de l’Oriental, de Beni Mellal-Khénifra, ou de Fès-Meknès, enregistrent des évolutions positives – bien que modérées – de leurs parts d’investissement entre 2025 et 2026, d’autres régions, notamment Drâa Tafilalet, Souss – Massa, Guelmim-Oued Noun ou Dakhla-Oued Eddahab, continuent de se voir attribuer des parts moins importantes, souvent inférieures à 3% de l’investissement total. Cette configuration accentue les disparités interrégionales et souligne les limites de l’effort redistributif des investissements publics actuels. (Rapport sur les Etablissements et Entreprises publics)
Pour ce qui est du PIB par habitant, les groupes de pays différent. Le classement est le suivant en partant du bas vers le haut : Draa-Tafilalet, Marakech-safi, Fes-Meknes (15000-25000 DH) ; Souss-Massa, Beni Mellal-Khénifra (25001-40000) ; Guelmim-Oued Noun, Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima (40001-50000) ; Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca Settat, Laayoune Saqiat Al hamra, dakhla Oued Addahab (50001-85000).
Dakhla, Oued Dahab au sommet
Les données portant sur l’année 2023 sont plus précises pour mesurer les disparités régionales sur la base du PIB par habitant. Ainsi, par rapport à une moyenne nationale du PIB/habitant, soit 34346, cinq régions enregistrent un PIB supérieur à la moyenne et 7 régions dégagent un PIB inférieur à la moyenne. La région de Tanger Tétouan Al Hoceima, malgré la dynamique économique qu’elle connait, enregistre un PIB proche de la moyenne. Les régions composant les provines sahariennes sont, avec Casablanca et Rabat-salé -Kénitra parmi les plus riches. Dakhla Oued Dahab se distingue avec un PIB/ha de 84142 DH devançant Laayoune de 26985 DH. Cette différence correspond au PIB/ha de Beni Mellal Khénifra. L’écart entre le PIB le plus élevé et le plus bas enregistré à Draa Tafilalet (19898 DH) va de 1 à 4,2 ! ce qui signifie qu’un habitant à Dakhla dispose en moyenne de plus de 4 fois le PIB moyen d’un habitant de Draa Tafilalet. Certaines données donnent à réfléchir: l’Oriental, classé au neuvième rang fait relativement mieux que Fes-Meknes (10ème rang) et Marrakech-Safi (avant dernier). La concentration de l’activité dans certaines villes couplée aux effets de la sécheresse et à une politique sociale défaillante expliquent en partie ce paradoxe. Ainsi, les revenus tirés du tourisme, dont Marrakech est parmi les 10 villes les plus attractives au niveau mondial, ne se propagent pas sur l’ensemble de la région. Marrakech-ville est entourée de provinces parmi les plus pauvres comme Chichaoua, El Haouz, Youssoufia. Le même phénomène est observé au niveau de la région de Fes-Meknes qui regroupe des provinces très pauvres comme Taounate, Taza, Boulemane …
Le capital privé sur la trace de l’investissement public
Encore faut-il préciser qu’on parle de moyennes arithmétiques qui ne prennent pas en considération la répartition des richesses produites et des revenus qui en découlent. Revenons au cas de Draa Tafilalet dont le PIB/ha est le plus bas. Un PIB annuel moyen de 19898 DH nous donne 54,5 DH par jour. Si on tient compte de la répartition inégale de la richesse, la majorité de la population se retrouverait avec 10 à 20 DH par jour ! Voilà ce que ne dit pas la répartition régionale de l’investissement public. C’est bien d’annoncer des objectifs comme le renforcement des servies sociaux et la mise à niveau territoriale intégrée. C’est bien également d’aligner des chiffres ambitieux sur l’investissement public qui remontent en 2026 à 380 milliards DH, soit plus de 20% du PIB. C’est bien aussi d’annoncer des montants colossaux des projets d’investissements privés tels qu’ils sont approuvés par la Commission Nationale que préside le Chef du Gouvernement, soit 250 projets pour un investissement de 414 milliards DH. Précisons, toutefois, que trois régions, Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra, s’accaparent 153 projets, soit plus de 60%. Le reste est réparti sur les autres régions. La région la moins lotie, Draa Tafilalet, attire à peine 4 projets. On retiendra de cette répartition que l’investissement privé suit la trace de l’investissement public. D’où la responsabilité de l’Etat de démocratiser la répartition des investissements publics comme prélude à une justice territoriale. A défaut de cette inflexion proclamée et voulue par la plus Haute Autorité du pays, la situation ne changera pas radicalement et on continuera toujours à verser des larmes de crocodile.