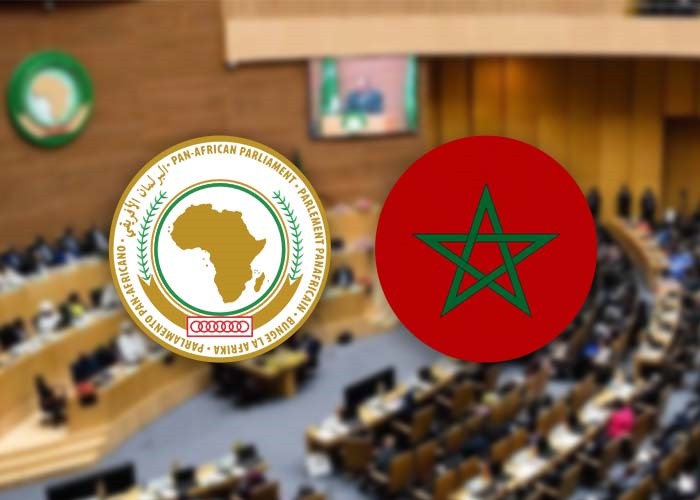Il fut un temps où Washington annonçait, la main sur le cœur, vouloir « sauver le peuple iranien ». Sous la présidence de Donald Trump, la mise en scène était spectaculaire : menaces de frappes massives contre Téhéran, tweets martiaux, ultimatums publics et déploiement d’armadas aériennes, terrestres et navales dans le Golfe. Porte-avions, bombardiers stratégiques, batteries antimissiles : tout l’arsenal d’une superpuissance était exhibé comme dans une superproduction hollywoodienne.
La dramaturgie était savamment entretenue : images satellites, briefings solennels au Pentagone, déclarations tonitruantes promettant « le feu et la fureur ». La pression maximale ne se jouait pas seulement dans les chancelleries, mais aussi sur la scène médiatique mondiale. À défaut d’une guerre déclarée, c’est une guerre des postures qui s’installait, où la démonstration de force devenait un outil de communication autant qu’un instrument stratégique. Les mollahs étaient voués aux gémonies, promis à une chute imminente. Sur certains plateaux occidentaux, notamment français, experts autoproclamés et stratèges de salon rivalisaient de certitudes : le régime iranien vivait ses dernières heures, la rue allait l’emporter, l’Histoire était en marche. L’argument moral était martelé avec insistance : violations des droits humains, répression sanglante, libertés piétinées. L’indignation semblait sincère, presque vibrante. Mais à y regarder de plus près, cette compassion sélective avait surtout des accents stratégiques.
Car non loin de là, dans la région, d’autres drames, notamment palestinien se jouaient dans un silence assourdissant ou sous un flot de justifications embarrassées. Lorsque des civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, tombaient sous les bombes sionistes à Gaza, une large partie des dirigeants et des médias occidentaux invoquaient sans rougir la « légitime défense » du bourreau israélien. Sous les gouvernements de Benyamin Netanyahou, la ligne sécuritaire demeurait constante et bénéficiait d’un solide appui diplomatique. Les accusations de crimes de guerre ou de violations massives du droit international humanitaire, portées par des ONG et des institutions internationales, étaient relativisées, contextualisées, parfois minimisées. Deux poids, deux mesures. D’un côté, l’Iran présenté comme l’incarnation du mal absolu, avec bande-annonce permanente et effets spéciaux géopolitiques ; de l’autre, un allié stratégique dont les actions sont enveloppées d’un manteau de compréhension diplomatique. Dans ce théâtre d’indignations sélectives, la morale sert trop souvent d’outil, non de principe. La vérité est moins romantique que les discours martiaux. La question des droits de l’homme dans le dossier iranien a surtout constitué, pour l’administration Trump, un levier inscrit dans une stratégie de « pression maximale ». L’objectif central restait le nucléaire iranien et le programme balistique, perçus comme une menace majeure pour les intérêts américains et, surtout, pour la sécurité de l’ami sioniste.
Dans le dossier iranien, ce qui apparaît au grand jour, c’est une réalité que beaucoup feignent d’ignorer : l’agenda semble largement dicté par les priorités sécuritaires colonisateur israélien.
“La cause iranienne “n’était qu’un habillage éthique d’une logique de puissance. Il ne s’agit pas d’absoudre la répression en Iran ni de minimiser les souffrances de la population. Mais il est permis de s’interroger : pourquoi certains peuples deviennent-ils soudainement des causes universelles, tandis que d’autres demeurent des variables d’ajustement diplomatique ? Pourquoi les principes invoqués avec solennité dans un dossier passent-ils par pertes et profit dans un autre ? Les droits de l’homme ne devraient pas être une monnaie d’échange dans les négociations nucléaires, ni un instrument rhétorique brandi au gré des calculs de domination. Cette instrumentalisation des principes par les grandes puissance finit par miner leur crédibilité ébranlée par des affaires scabreuses qui ont exposé les zones d’ombre des élites occidentales, à l’image du scandale Jeffrey Epstein. Le peuple iranien mérite mieux qu’un soutien conditionnel. Le peuple palestinien mérite mieux qu’une compassion prudente. Et le monde mérite une diplomatie qui applique les principes que l’Occident proclame.
Dans le dossier iranien, ce qui apparaît au grand jour, c’est une réalité que beaucoup feignent d’ignorer : l’agenda semble largement dicté par les priorités sécuritaires colonisateur israélien. Sous Benyamin Netanyahou, la ligne reste la même : empêcher à tout prix l’Iran d’accéder à la capacité nucléaire militaire, quitte à pousser Washington vers l’escalade. De l’abandon de l’accord sur le nucléaire aux menaces de frappes, la convergence entre la Maison-Blanche de Trump et le régime sioniste n’avait rien d’un hasard. Il s’agit non pas de contester le droit d’Israël à sa sécurité, mais de rappeler qu’il ne peut être durablement garanti sans la reconnaissance simultanée du droit du peuple palestinien à vivre en paix, dans la dignité et au sein d’un État souverain et viable. La véritable question porte aussi sur le degré d’indépendance de Washington lorsque les lignes rouges israéliennes se muent, presque par réflexe, en lignes rouges américaines. Quand la diplomatie s’efface au profit d’une stratégie de pression maximale dictée par le diktat d’un allié, il ne s’agit plus d’un partenariat équilibré, mais d’un alignement qui confine à la dépendance.
Dans ce jeu d’influences, l’indignation morale sert de décor ; le déploiement militaire, de bande-son. Le véritable enjeu reste l’équilibre des forces au Moyen-Orient, la dissuasion, et la préservation d’une supériorité stratégique régionale. Et pendant que les puissances ajustent leurs postures — parfois avec le sens du spectacle d’un blockbuster diplomatique — ce sont toujours les peuples, iranien, palestinien et bien d’autres, qui paient le prix des calculs géopolitiques. On aimerait voir la même détermination, la même rhétorique martiale, la même diplomatie de la pression s’appliquer lorsque le droit international est invoqué ailleurs. Si Washington se veut le champion des droits humains, pourquoi cette énergie ne se traduit-elle pas par des exigences claires et contraignantes pour mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens et aux violences contre les civils ? Pourquoi les sanctions, les ultimatums et les démonstrations de force sont-ils réservés à certains régimes, tandis que d’autres bénéficient d’une indulgence qui crève les yeux ? Si les principes sont universels, leur application devrait l’être aussi.
À défaut, le discours moral s’affaiblit et alimente l’idée d’un ordre international régi par des doubles standards, où l’application du droit dépend moins des principes proclamés que de l’identité de l’allié concerné. C’est cette asymétrie qui fragilise la crédibilité occidentale : l’impression que les principes invoqués ne valent que lorsqu’ils servent les intérêts des puissances.