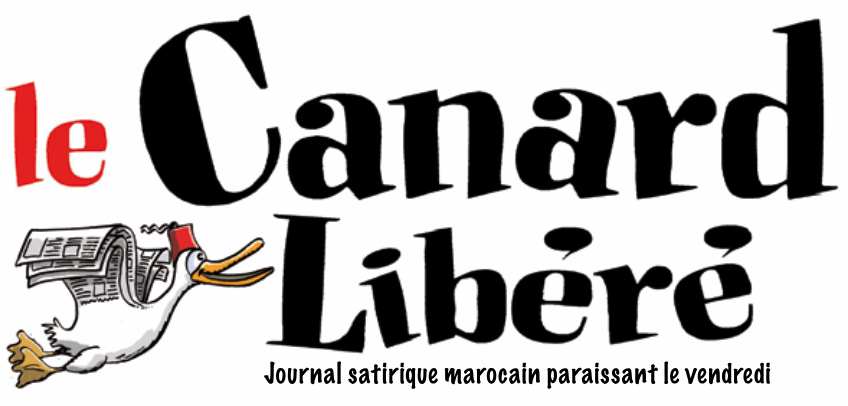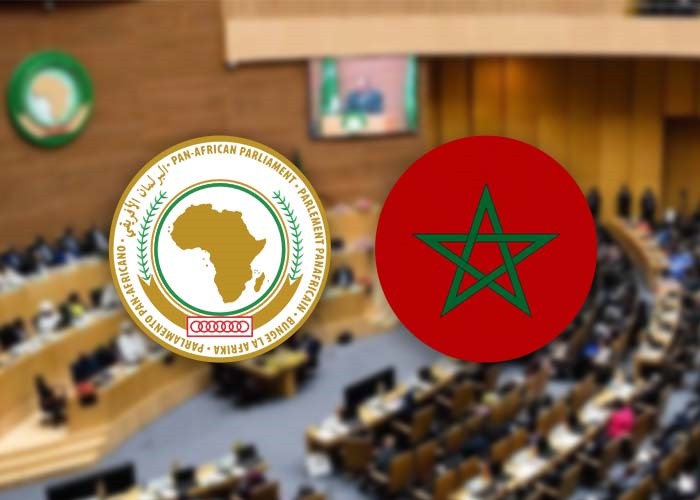Elles devaient incarner la renaissance de l’école publique marocaine. Elles sont aujourd’hui au cœur d’un tumulte politique et médiatique intense. Explications.
Les écoles pionnières مدارس الريادة, lancées par le ministère de l’Éducation nationale en septembre 2022 dans le cadre de la feuille de route 2022-2026, pour relever le niveau des apprentissages fondamentaux, sont cloués au pilori. Des députés interpellent le gouvernement, certains demandent même l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire pour évaluer le programme, ses résultats, et débusquer ses dérives. L’idée du chantier est louable : créer, au sein de l’école publique, des établissements où les élèves apprennent réellement à lire, écrire et comprendre, grâce à des effectifs réduits, un encadrement pédagogique strict et une méthodologie inspirée des meilleurs standards internationaux. Plus de 600 écoles y participent aujourd’hui. Mais cette nouvelle expérimentation éducative est devenue un sujet de controverse dès que certains responsables ont affirmé qu’un élève d’une école pionnière équivaut à 70 ou 80 élèves d’une école ordinaire. La formule choque. Dans l’hémicycle, des parlementaires dénoncent une discrimination institutionnalisée entre élèves de première zone et élèves de seconde zone. Une école à deux vitesses au sein du même système public ? Sur le terrain, les résultats sont visibles : les élèves lisent mieux, écrivent sans fautes majeures, prennent la parole avec assurance. Des enseignants, formés à une méthode strictement structurée — décomposition des sons, répétition orale, apprentissage quotidien — défendent le programme, saluant une progression inédite. Mais d’autres qui ne l’entendent pas de cette oreille sonnent l’alerte : la méthode fabrique des lecteurs mécaniques, capables de lire un texte sans en saisir le sens, de recopier sans réfléchir. « Ils déchiffrent, mais ne pensent pas », confie un enseignant interrogé dans la presse. Face à ces critiques, le débat se déplace sur le terrain politique.
À la Chambre des représentants, plusieurs députés réclament la création d’une commission d’enquête parlementaire. Ils veulent savoir comment ces écoles ont été sélectionnées, l’usage fait des budgets alloués, quelles entreprises ou associations ont été mandatées pour former les enseignants, et pourquoi certaines régions semblent mieux loties que d’autres. Ce qu’ils contestent, ce n’est pas la piste de réforme qui a enfanté les écoles pionnières, mais de voir l’école publique se fragmenter entre établissements “modèles” et écoles « laissées pour compte ». Dans l’entourage du ministre Mohamed Saad Berrada, on balaie ces griefs d’un revers de la main, en dénonçant un procès d’intention et une politisation du dossier. Le ministère assume sa ligne réformatrice. Il rappelle qu’il ne s’agit pas de créer une élite au sein du public, mais de poser les bases d’une méthode qui sera progressivement généralisée à toutes les écoles du Royaume. Des établissements-pilote en quelque sorte… Pour le département de l’Éducation nationale, refuser l’expérimentation reviendrait à accepter l’échec généralisé, celui de milliers d’élèves sortant du primaire sans savoir lire un texte ni écrire une phrase correcte. Ce débat dépasse les salles de classe. Il interroge la vision même de l’école marocaine : doit-elle viser l’excellence, quitte à créer des écarts temporaires, ou préserver l’égalité, quitte à freiner l’amélioration ? C’est cette question qui nourrit la controverse — entre urgence d’agir et peur d’exclure, entre volonté de réforme et méfiance envers le département de tutelle. Une chose est sûre: à travers le succès comme à travers la contestation, les écoles pionnières obligent le Maroc à se poser la seule question qui compte vraiment : quelle école voulons-nous pour nos enfants — et à quel prix ?