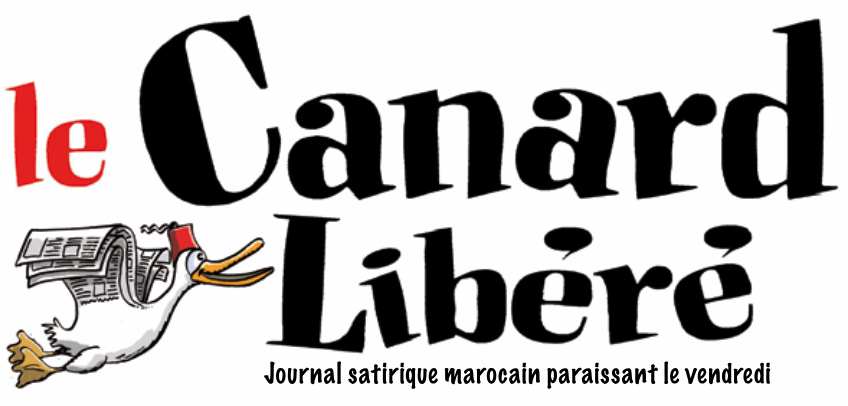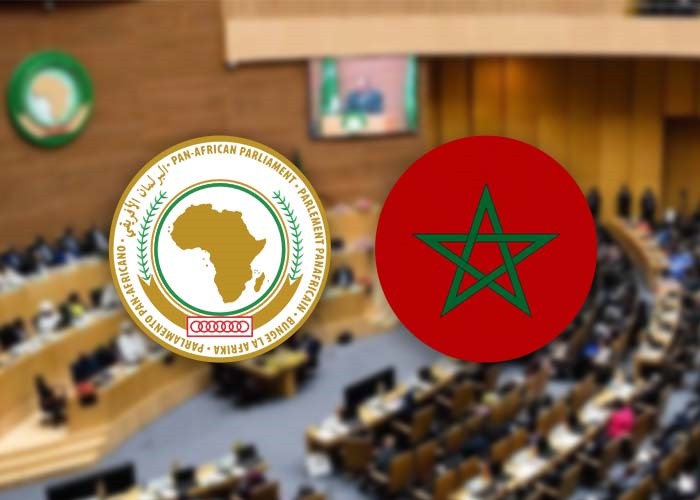Six mois après avoir imposé une interdiction générale d’abattage des femelles ovines et caprines, le ministère de l’Agriculture vient d’assouplir sa position. La décision signée le 24 septembre par Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, limite désormais cette interdiction aux seules femelles en état de gestation apparente. Un revirement qui suscite autant d’interrogations que d’explications. Les autorités de tutelle invoquent des données statistiques rassurantes. Le recensement national du cheptel, mené entre juin et août 2025, aurait révélé un noyau reproductif solide: 23,15 millions d’ovins dont 16,34 millions de femelles, et 7,47 millions de caprins dont 5,29 millions de femelles. À cela s’ajoutent 9,4 millions de naissances, portant le cheptel reproducteur à près de 14 millions de têtes âgées de plus d’un an. De plus, l’annulation du sacrifice de l’Aïd al-Adha, mesure exceptionnelle prise en 2025, a permis de préserver environ 3 millions de femelles supplémentaires.
Pour Hassan Agdim, directeur de ladDivision des filières animales au ministère de l’Agriculture, ce choix s’inscrit dans une stratégie de long terme : « La reconstitution du cheptel est effective et le secteur se porte mieux, avec une perspective d’atteindre 33 millions de têtes. Nous comptons aujourd’hui 16 millions de femelles et prévoyons 8 millions de naissances avant la fin de l’année. Cette dynamique permettra d’alimenter le marché en viande et de renforcer les revenus des agriculteurs. » Si l’argumentaire semble solide, la décision soulève néanmoins des interrogations. Comment concilier la volonté affichée de « proliférer le cheptel national » avec une ouverture, même partielle, de l’abattage des femelles ? La prudence adoptée au printemps dernier, face à des risques de contraction du cheptel, n’est plus de mise alors même que les effets de la sécheresse, de la pression démographique et des fluctuations du marché international continuent de peser sur la sécurité alimentaire. En réalité, cet assouplissement traduit un compromis délicat: répondre à court terme aux besoins de consommation de viande et aux attentes des éleveurs en quête de revenus, tout en maintenant un noyau reproductif jugé suffisant pour garantir la pérennité du cheptel. Mais la question demeure : cette équation fragile pourra-t-elle tenir face aux aléas climatiques et aux cycles de reproduction qui, par nature, exigent du temps et de la constance ? Et puis question capitale : cet assouplissement agira-il sur les prix des viandes rouges à la baisse ?