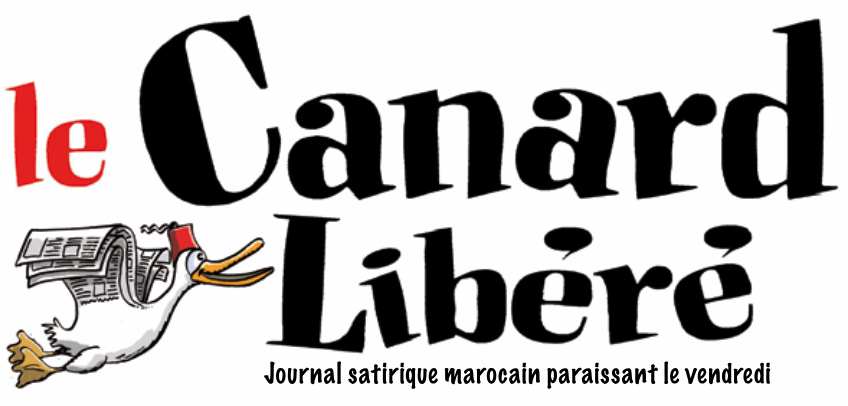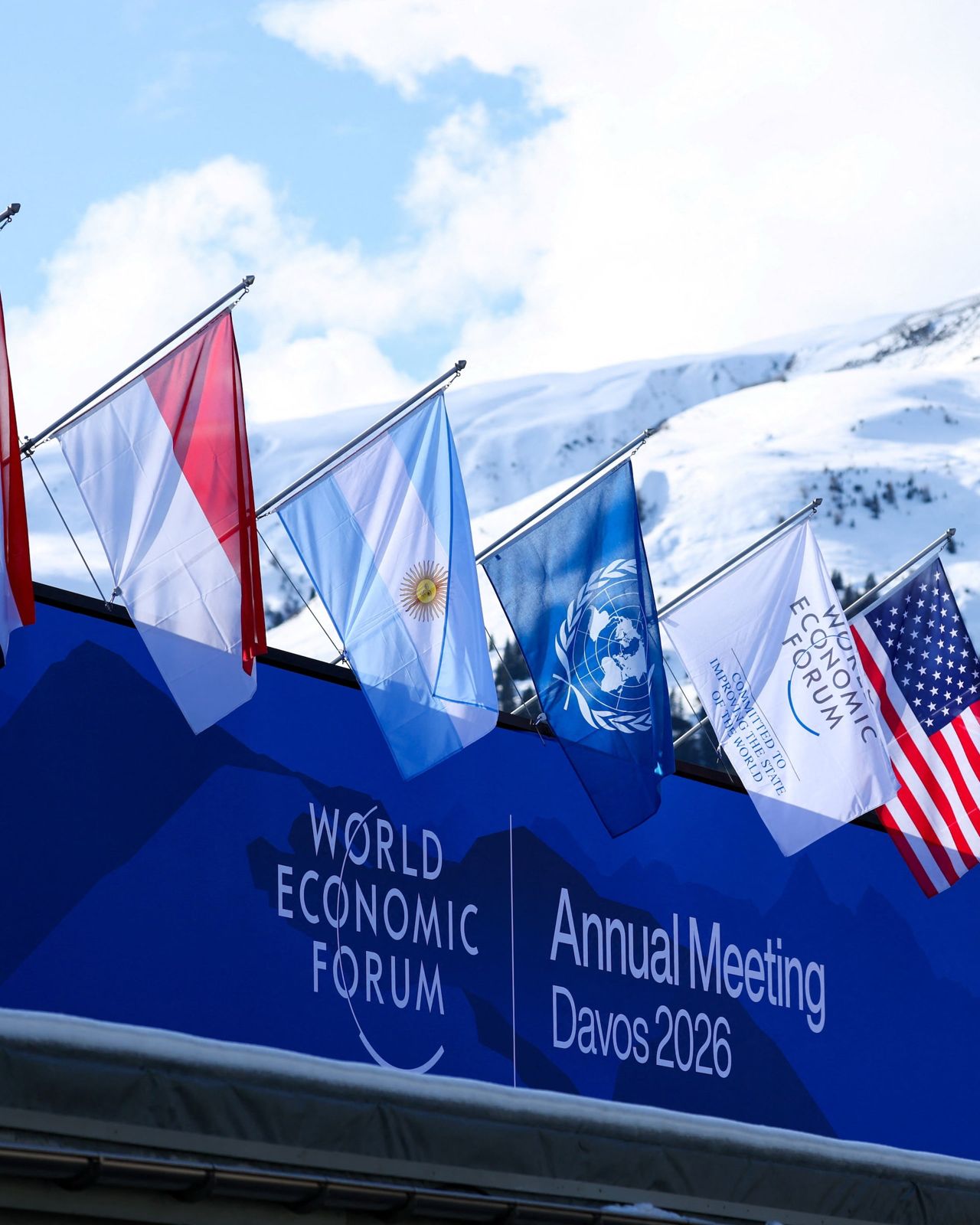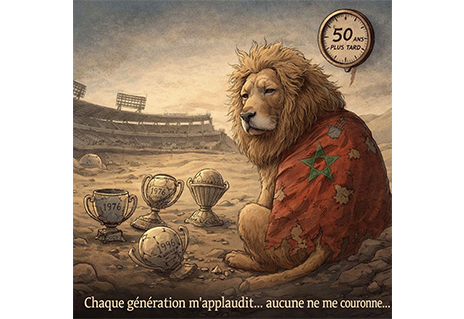Laila Lamrani
Le 23 novembre 2025, une frappe israélienne a ciblé le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, tuant Haytham Ali Tabatabai, chef d’état‑major du Hezbollah, ainsi que quatre autres militants.
Pour les sionistes criminels de Tel Aviv, cette opération constitue la première attaque sur la capitale libanaise depuis plusieurs mois, et vise à entraver la reconstitution militaire du groupement chiite. Le Liban et l’Iran ont dénoncé une violation flagrante du cessez‑le‑feu de novembre 2024.
Tabatabai, né en 1968 à Beyrouth et d’ascendance iranienne du côté paternel, est une figure clé du Hezbollah depuis les années 1980. Il avait commandé la force d’élite « Radwan », œuvré en Syrie et au Yémen, puis assumé depuis la fin de la guerre de 2023 les fonctions de chef d’état‑major du mouvement.
Pour les assassins de tel Aviv, il représentait une « licence de tuer» : un recruteur, logisticien et organisateur de frappes anti‑israéliennes.
Selon le sanguinaire en chef Benjamin Netanyahu, cette frappe marque l’impossibilité pour le Hezbollah de se reconstituer librement. La zone ciblée est un bastion du Hezbollah. L’organisation a averti qu’elle « répondrait en temps voulu ».
L’attaque survient malgré la trêve récente et dans un lieu densément peuplé, ce qui augmente les risques pour les civils Avec l’assassinat de Tabatabai, le Hezbollah perd un pilier militaire tout en ayant la possibilité d’un regain de popularité si une riposte est décidée. Pour l’agresseur israélien, il affirme avec ce énième crime avec sa doctrine « frappe sans avertissement », mais s’expose à de lourdes représailles.
Pour le Liban, cette affaire pose un défi majeur à sa souveraineté, tandis que son armée et son État apparaissent de plus en plus impuissants. Pour la région enfin, les tensions israélo‑libanaises, aujourd’hui concentrées à la frontière nord, pourraient s’étendre à Beyrouth et au‑delà. Ces assassinats confirment la primauté de la loi du plus fort dans les relations internationales, surtout lorsque les rapports de force militaires et diplomatiques sont déséquilibrés.
Le colonisateur israélien, qui bénéficie du soutien constant des États-Unis et d’une supériorité militaire aérienne remarquable , agit fréquemment de manière unilatérale, estimant que sa sécurité prime sur les règles internationales et celle de ses voisins. En face, des États comme le Liban, affaiblis politiquement, divisés en interne et peu soutenus sur la scène mondiale, ont peu de moyens de se défendre autrement que symboliquement ou via des acteurs non étatiques comme le Hezbollah.
Le Conseil de sécurité de l’ONU, censé faire respecter le droit international, est souvent paralysé par le droit de veto des grandes puissances, ce qui rend la justice internationale à géométrie variable. Dans ce contexte, le plus fort frappe, le plus faible encaisse, et le droit est relégué au second plan.